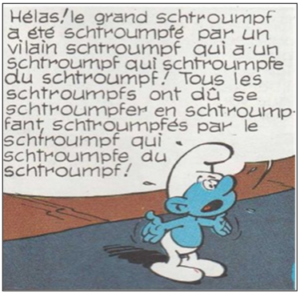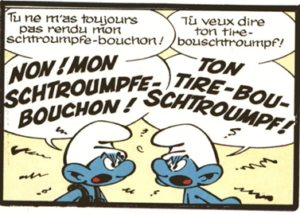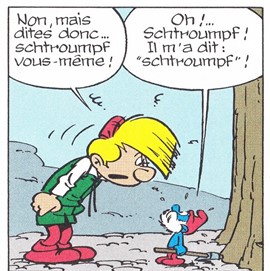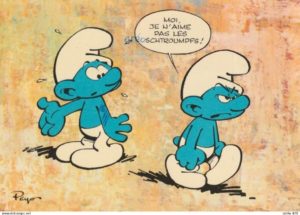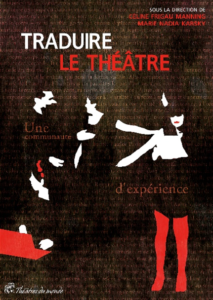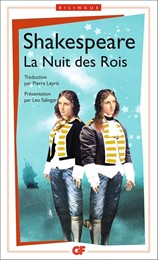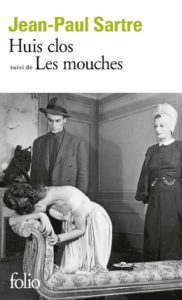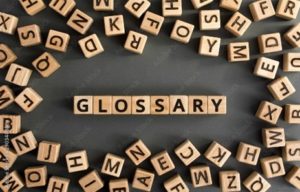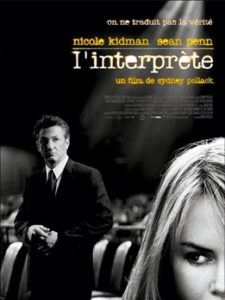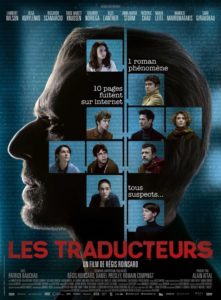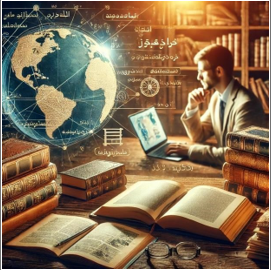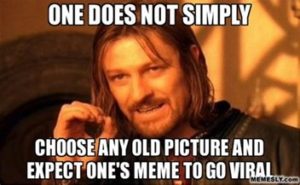Traiter les jurons et insultes et autres joyeusetés en traduction littéraire
Mots-clés : traduction littéraire ; registres de langue ; cultures
Les jurons sont présents dans chaque langue. Ils sont le reflet des tabous de la culture à laquelle ils sont rattachés en incarnant la transgression. Ils sont généralement prononcés de façon spontanée, parfois dans le but de choquer.
L’emploi de jurons en littérature peut contribuer à forger le caractère d’un personnage ou à renforcer certains aspects d’une scène donnée.
Les insultes quant à elles peuvent être composées de jurons et elles peuvent prendre plusieurs formes. Par exemple, certaines insultes visent à déshumaniser la personne à qui elles sont adressées en la comparant à un animal tandis que d’autres ont une connotation sexuelle.
Dans le domaine littéraire, la question pour le traducteur reste de trouver des alternatives à tous ces termes et expressions tout en restant en accord avec l’histoire et le contexte.
Jurons = intraduisibles ?
Nous avons pu constater que les jurons sont rattachés à une culture. Or, si chaque culture représente une vision du monde, comment peut-on trouver des alternatives dont le sens est entièrement fidèle à la source ?
La langue ne possède pas toujours un terme désignant une idée spécifique provenant d’une autre culture. Elle peut seulement fonctionner par similarités en comparant à sa propre culture, ce qui rend nécessairement la traduction approximative dans certains cas. Les tabous ne sont pas les mêmes selon les cultures, bien que l’on puisse parfois trouver des points communs entre certaines cultures.
Par exemple, dans un pays ancré dans la religion tel que les États-Unis, les jurons blasphématoires sont plus fréquemment employés que dans un pays laïc comme la France. Ainsi, l’expression anglaise « goddamn », qui est fréquemment employée à titre de juron (jusqu’à être parfois même censurée dans les contenus publiés sur les réseaux sociaux), devrait être traduire par « nom de Dieu » en français qui est l’expression se rapprochant le plus du sens de l’expression anglaise. Pourtant, cette alternative n’est plus autant utilisée en France et peut sembler désuète. Dans le cas d’une traduction, cette expression pourrait ne pas convenir si le personnage s’exprime dans un contexte actuel, signe que, non seulement les jurons dépendent des cultures, mais aussi qu’ils évoluent avec leur culture (un facteur essentiel à prendre en compte en tant que traducteur). On préfèrera alors des alternatives moins proches sur le sens mais plus cohérentes par rapport au contexte.
Une autre contrainte lors de la traduction des jurons est liée à la langue elle-même. En anglais, beaucoup de termes peuvent être « transformés » en jurons simplement en ajoutant « fuck » devant eux (par exemple, l’expression « fuckloads of » pour désigner « une tonne de »). La grammaire française rend la traduction de ce procédé plus difficile. Il faut alors trouver des compromis afin de conserver cette idée de familiarité et de juron, quitte à placer un juron ou un procédé équivalent à un autre moment de la phrase.
Cela ferait-il donc des jurons une partie intégrantes des intraduisibles si redoutés des traducteurs ? C’est tout à fait possible, cependant il est important de voir les intraduisibles comme des difficultés à traiter minutieusement plutôt que des barrières hermétiques à la traduction.
Des insultes, oui, mais du registre familier, pas forcément !
Tout d’abord, il me semble important de signaler un biais que nous avons souvent lorsqu’il s’agit de jurer dans sa langue maternelle ou dans une autre langue : nous avons plus de scrupules à jurer dans notre propre langue. Ce phénomène est probablement dû à l’ancrage dans notre culture faisant que nous avons intégré ses mœurs et surtout ses tabous. La notion de tabou nous paraît alors moins présente dans une autre culture. Il est donc plus facile de jurer dans une autre langue car nous ressentons moins cette idée de transgression.
J’ai pu ressentir ces scrupules lors de ma première traduction littéraire mais la demande qu’a formulé l’auteur (Américain) de réduire le nombre de jurons en français m’a laissé penser que les Français sont peut-être aussi plus « élitistes » sur l’écriture et l’usage de la langue. Le traducteur peut alors se sentir obligé de ne pas abuser de jurons sous peine de déplaire à une grande partie des lecteurs qui verraient le texte comme simplement « mal écrit ».
Afin de contourner ces contraintes, il est important de se rappeler qu’en français, n’importe quel terme peut être employé à titre d’insulte en fonction du contexte et de l’intention. L’un des exemples les plus célèbres de la littérature est probablement le capitaine Haddock et ses expressions toutes plus rocambolesques que les autres. Lui ne se contente pas d’insulter comme dans d’autres bandes dessinées à coups de « 💥@#☠️! » mais en employant soit des termes non familiers considérés comme dégradants, soit en employant des termes qui n’ont, à priori, rien d’insultant (qui s’offusquerait sincèrement d’être traité d’ornithorynque ?). Il s’agit d’insultes plus « familiales » où le registre familier est totalement absent et où on reconnaît leur nature d’insultes par le contexte. La traduction de ces termes en anglais est souvent littérale pour les termes neutres (« ascenseur »). Parmi les changements opérés par le traducteur anglais, on retrouve « boit-sans-soif » traduit en « jellied-eel » (signifiant gelée d’anguille, un plat londonien qui, soit dit en passant, ne semble pas très appétissant) ou encore l’omission complète de « Jocrisse », un personnage de comédie incarnant la sottise et la naïveté (référence peut-être moins commune pour les anglophones).
Conclusion sur l’emploi du registre familier et de l’oralité en littérature (ou comment rendre un personnage vulgaire)
Un juron n’en vaut pas un autre. Le fait de jurer est, certes, un acte spontané, la traduction de jurons et d’insultes, elle, ne l’est pas. Il est essentiel pour le traducteur de choisir avec soin l’alternative d’un juron dans la langue cible car chaque juron a une connotation une typologie différente. La traduction des jurons et des insultes dans la littérature ne se résume pas à des mots mais il s’agit d’une traduction de termes, de concepts culturels tout en prenant en compte le contexte donné.
Quelques références :
Édouard, R., & Carassou, M. (1983). Dictionnaire des injures.
Enckell, P. (2004). Dictionnaire des jurons. Presses Universitaires de France – PUF.
(pour les grands amateurs de linguistique)
Carmen Gonzalez Martin. Étude de pragmatèmes : salutations, injonctions et jurons. Linguistique. Université Paris-Nord – Paris XIII, 2019.
URL : https://theses.hal.science/tel-03022503v1/file/ederasme_th_2019_gonzalez.pdf
(pour avoir une vue plus globale sur les jurons dans langues francophones)
Kasparian, S., & Gérin, P. M. (2005). Une forme de purification de la langue : étude des jurons et des gros mots chez des minoritaires francophones, le cas des Acadiens. Francophonies d’Amérique, (19), 125–138.
URL : https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2005-n19-fa1813267/1005314ar.pdf
(pour voir les différences entre la traduction des jurons en France et au Canada)
Pajunen, M. (2005). Le temps de la traduction : Une étude comparée de la traduction des anglicismes et des jurons dans les deux traductions françaises de The Catcher in the Rye [Mémoire de maîtrise, Université de Tampere].
URL : https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/92889/gradu00676.pdf;jsessionid=03F2498C0F27147B96BDA18D6FEC1DB3?sequence=1
Na’vi : un rêve bleu devenu réalité
Par Amaury TINOT, Master TPS, promotion 2024-2025
En 2009, James Cameron mettait des étoiles dans les yeux des spectateurs avec Avatar, premier opus de ce qui est désormais prévu pour devenir une véritable pentalogie. Lors du deuxième épisode, La Voie de l’eau, sorti en 2022, le monde de Pandora montrait une autre de ses faces, passant de la terre à la mer, et nous pouvions à nouveau observer le peuple — ou plutôt les peuples — Na’vi, leur mode de vie, ponctué de conversations dans une langue que nos oreilles avaient appris à reconnaître plus de dix ans auparavant. Mais une telle langue peut-elle exister ?
Et la réponse est doublement oui ! Tout d’abord parce que c’est une « vraie » langue, au sens qu’il ne s’agit pas d’un simple cryptage ou code d’une langue terrienne préexistante mais bien d’une authentique conlang (constructed language), mais également car le Na’vi repose sur des bases linguistiques tout ce qu’il y a de plus vraisemblables.
Paul Frommer (source : Unidentified Sound Object)
We’re the Na’vi
Pour comprendre la génèse de la langue Na’vi, il faut remonter à celle du film lui-même. En 2005, alors que le film n’était encore qu’un scénario (scriptment, dans les mots de l’auteur), James Cameron fit appel à un spécialiste pour donner vie à la langue des extra-terrestres de la planète Pandora. Le réalisateur avait bien créé quelques dizaines de mots, mais souhaitant procurer à la future langue Na’vi une aura de concret et de vraisemblable, il décida de confier la tâche de l’élaboration d’une langue à part entière au linguiste Paul Frommer, recommandé par l’un de ses collègues, Edward Finegan, professeur de linguistique à l’Université de Californie du Sud (USC).
Après une heure et demi de discussion entre le réalisateur et le linguiste, le projet était lancé, validé par un « Welcome aboard » chaleureux de James Cameron accompagné d’une poignée de main entre les deux hommes.
Montage par melissa sur wallpapers.com
Si loin, et à la fois si proche
Avant de rentrer dans le vif du sujet linguistique, il est important de noter qu’un certain travail d’élagage avait été effectué en amont. Paul Frommer avait soumis à James Cameron trois propositions générales de concepts qui serviraient à créer des distinctions utiles entre les mots : un système d’accent tonique (stress), un autre jouant sur la longueur des voyelles, et enfin un système tonal — comme en chinois. C’est finalement la première proposition qui sera retenue.
Pour créer une langue relativement réaliste et enrichissable, il lui fallait non seulement une phonologie mais également une phonétique, une morphologie, une syntaxe et un lexique conséquent. Le choix des sons présents en Na’vi s’est fait sur une base simple : agréables à l’oreille des spectateurs et prononçables par les acteurs. Ajoutons que la morphologie — physique cette fois-ci — et les réflexes des Na’vi eux-mêmes avaient aussi attiré l’attention de divers esprits créatifs de l’équipe de réalisation. Comparable à ceux des félins, les mouvements de queue et d’oreilles des géants bleus sont complémentaires de leur langue, faisant donc pleinement partie de leur système de communication et de leur langage au sens large — nous reviendrons d’ailleurs plus tard sur la question des affects en Na’vi.
Bien que les premiers mots Na’vi créés par James Cameron aient, d’après Paul Frommer, une certaine consonance polynésienne, ce dernier semblait déterminé à créer une langue sans pareil. Sans pareil, dans la mesure où elle n’évoquerait aucun parler terrien en particulier une fois arrivée à nos oreilles, mais serait encore une fois parfaitement prononçable par un être humain, et donc apprenable, comme on a pu voir certains colons terriens le faire dans les films. Autrement dit, tous les sons et concepts linguistiques
Neytiri dans le premier Avatar (Looper.com)
présents en Na’vi existent ou ont existé quelque part sur Terre (souvent à une moindre échelle) mais leur combinaison est unique.
« Je te vois »
Enfin, si la langue du peuple d’Eywa vous a charmé dans les salles obscures, passons à quelques généralités sur le fonctionnement pratique du Na’vi, à commencer par sa phonétique. Si parmi les consonnes on trouve certains suspects habituels, comme la triplette [p] [t] [k], leurs équivalents voisés ([b] [d] [g]) en sont tout simplement absents : en revanche, nos trois consonnes sourdes possèdent toutes une version éjective, notée avec un « x » (px, tx, kx). On reconnaîtra également le [ŋ], bien connu des anglophones, ou encore le « coup de glotte », [ʔ], présent notamment en arabe, et marqué par le signe ⟨ʼ⟩ — hé oui, l’apostrophe dans le mot « Na’vi » n’est pas cosmétique, elle se prononce ! Quant aux voyelles (monophtongues), il en a sept : [i], [ɪ], [u ~ ʊ], [ɛ], [o], [æ] et [a]. Le Na’vi ne possédant pas d’alphabet propre, il faut passer par l’alphabet phonétique international (API) et par des romanisations.
Syntaxiquement, le Na’vi jouit d’une souplesse assez confortable : dans le cas général, les éléments de la phrase peuvent être énoncés dans un ordre très libre, qui reste compréhensible grâce au système de cas (à vous les « Belle Marquise » devant vos contemporains). De même, le mot sur lequel porte un adjectif est aisément identifiable grâce à la voyelle /a/, placée au début ou à la tout fin de tout adjectif selon si le mot qu’il qualifie est à sa gauche ou à sa droite.
Mais n’allons pas oublier l’outil majeur qui gouverne nombre de langues : le verbe. Si le Na’vi a, comme le français, son lot de préfixes et de suffixes, sa flexion verbale se fait via des infixes. Vous allez donc placer la marque de votre passé/passé proche, futur/futur proche dans votre verbe, avec éventuellement une nuance d’aspect accompli/inaccompli. Mais ce n’est pas tout ! Vous pouvez également ajouter des infixes témoignant de votre humeur, de l’incertitude de votre jugement, ou une certaine politesse ou déférence. D’ailleurs, la salutation iconique « oel ngati kameie »*, courante chez les peuples Na’vi, et qui se traduit littéralement par « je te vois », contient la marque de l’affect positif — dans l’intention ce serait « je suis content de te voir », idéal donc pour commencer en bons termes.
* ou bien « ngati oel kameie » ou encore « oel kameie ngati », si vous avez suivi 😉
Le protagoniste, Jake Sully, accompagné de Neytiri et de leurs enfants (ScreenRant)
Nostalgiques du premier film, spectateurs impatients de poser les yeux sur l’opus à venir, joueurs de Frontiers of Pandora, avides lecteurs de fiction ou encore linguistes de passage fascinés par ce parler aussi singulier que familier… tant de manières de plonger dans un univers ponctué de ces mots chantants qui sont ceux de la langue née de l’esprit de James Cameron et Paul Frommer, et enrichie par une communauté de passionnés. À ce jour, le lexique du Na’vi compte plus de 2900 mots selon certaines sources, nombre voué à augmenter comme pour toute langue animée par ses locuteurs, dont vous, qui lisez ceci, pourriez bien faire partie si l’envie vous en prend. En espérant que cet aperçu vous ait plu, kìyevame ma’eylan !
Mots-clés : Na’vi, linguistique, Avatar, Pandora, langue construite, conlang, fiction
Sources :
Milani, Matteo. « An interview with Paul Frommer, Alien Language Creator for Avatar ». Unidentified Sound Object, 24 novembre 2009.
URL : https://usoproject.blogspot.com/2009/11/interview-with-paul-frommer-alien.html
Annis, William S. Horen, Lì’fyayä leNa’vi, A Reference Grammar of Na’vi. 9 mars 2024.
URL : https://kelutral.org/uploads/6/1/3/2/61325997/horen-lenavi__1_.pdf
Sources des images :
https://www.otakia.com/10131/actualites/avatar-apprenez-le-langage-navi-gratuitement/
https://wallpapers.com/wallpapers/avatar-jake-sully-6c5jfwidrvpznl2u.html
https://www.looper.com/867881/the-untold-truth-of-neytiri-from-avatar/
https://screenrant.com/avatar-jake-neytiri-all-kids-family-tree/
Quand les mots façonnent l’immersion
Le rôle de la traduction dans l’industrie du jeu vidéo
Par Claire Gascoin, Master TPS, promotion 2024-2025
L’industrie du jeu vidéo est aujourd’hui un marché mondial pesant plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour toucher un public international, les éditeurs doivent adapter leurs jeux à différents marchés, une tâche qui repose en grande partie sur la traduction et la localisation. Une bonne traduction peut propulser un jeu au rang de succès mondial, tandis qu’une mauvaise adaptation peut ruiner son expérience et sa réception.
De la traduction à la localisation : bien plus qu’une question de langue
Lorsqu’un jeu est conçu, il est généralement développé dans une langue source, souvent l’anglais ou le japonais, avant d’être traduit vers d’autres langues. Toutefois, la traduction ne se limite pas à un simple transfert de mots : elle implique une localisation complète du contenu pour s’adapter aux références culturelles, aux expressions idiomatiques et aux attentes des joueurs.
Par exemple, certaines blagues ou jeux de mots peuvent perdre tout leur sens lorsqu’ils sont traduits littéralement. Un bon exemple est la série Phoenix Wright: Ace Attorney, où les noms des personnages et les références culturelles ont été repensés pour coller aux attentes du public occidental. Dans le cas inverse, une localisation bâclée peut briser l’immersion et donner naissance à des dialogues absurdes, comme en témoigne la fameuse phrase mal traduite de Zero Wing (1989) : « All your base are belong to us ».
Entre chef-d’œuvre et catastrophe : l’importance de la traduction sur l’expérience du joueur
Une mauvaise traduction peut nuire à l’expérience du joueur et, dans certains cas, impacter les ventes d’un jeu. Une mauvaise adaptation des dialogues, des sous-titres ou des menus peut rendre un jeu confus, voire injouable. Par exemple, Final Fantasy VII, dans sa version anglaise initiale, comportait des erreurs de traduction qui rendaient certains éléments du scénario difficiles à comprendre.
D’un autre côté, certaines localisations réussies participent activement au succès d’un jeu. La saga The Witcher, développée en Pologne, doit en partie son immense popularité à son excellente localisation anglaise et française, qui a su conserver l’essence et l’humour des dialogues tout en les adaptant aux sensibilités culturelles des joueurs.
L’IA à la recousse ? Les nouveaux défis dans le secteur vidéoludique
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et la traduction automatique assistée par ordinateur jouent un rôle croissant dans la localisation des jeux. Toutefois, la technologie ne peut pas encore remplacer totalement l’intervention humaine, notamment pour l’adaptation des références culturelles, l’humour et l’émotion dans les dialogues.
Un autre défi est la gestion des langues complexes et des langues moins courantes. Alors que les jeux AAA sont souvent traduits dans plus de 10 langues, de nombreux jeux indépendants n’ont pas toujours les moyens d’assurer une localisation complète, ce qui peut limiter leur portée internationale.
La traduction et la localisation sont devenues des éléments essentiels dans l’industrie du jeu vidéo. Un jeu bien traduit peut conquérir un public mondial, tandis qu’une mauvaise adaptation peut ternir son image et nuire à son succès. Avec l’évolution des technologies et la demande croissante pour des jeux accessibles dans plusieurs langues, le rôle des traducteurs et localisateurs est plus important que jamais pour offrir une expérience immersive et fidèle à tous les joueurs.
Savez-vous schtroumpfer le Schtroumpf ?
Par Martin Hennion, Master TPS, promotion 2024-2025
Véritables phénomènes culturels, les Schtroumpfs ont ravis les cœurs des petits et des grands du monde entier. Si les petits êtres bleus de Peyo charment les foules depuis 1958 par leurs aventures rocambolesques et leur univers aussi coloré qu’enchanteur, les Schtroumpfs fascinent également à cause d’une particularité qui leur est propre : leur langue !
Cours de linguischtroumpf générale
Avant de se plonger dans l’analyse des liens étroits entre la linguistique et les Schtroumpfs, il est bon de rappeler que cette langue, de prime abord simpliste, peut se révéler être d’une richesse sémantique étonnante. Pour parler la langue schtroumpfe, me direz-vous, il suffit de remplacer les substantifs par « schtroumpf », les verbes par « schtroumpfer » et les adverbes par « schtroumpfement » (nous ne parlerons pas des mots-composés, dont le débat constitue l’intrigue principale du neuvième album des aventures des Schtroumpfs, Schtroumpf vert et vert schtroumpf). C’est un bon début, mais il reste bien plus de subtilités dans cette drôle de langue.
Après tout, bien que les phrases prononcées par ces petits personnages de fiction soient truffées de mots « schtroumpfés », il est possible d’en comprendre le sens grâce à une gymnastique intellectuelle aussi rapide que ludique. Il arrive parfois que le sens nous échappe totalement (se référer à la première case de l’article) mais ce n’est que dans le but de créer une situation humoristique. Si nous sommes tous capable de comprendre la langue schtroumpfe, c’est parce qu’elle fait ce qu’aucune autre langue ne peut se permettre de faire : baser tout son sens sur le contexte.
Les Schtroumpfs et la sémiotique
Car la véritable richesse de la langue schtroumpfe ne se situe pas dans son vocabulaire mais dans son contexte, qu’il soit textuel, visuel ou culturel. Pour Umberto Eco, « les Schtroumpfs se comprennent parfaitement bien et nous les comprenons [car la] langue schtroumpf répond aux règles d’une linguistique du texte, chaque terme n’étant compréhensible que si on le saisit dans son contexte et que l’on interprète selon le thème ou topic textuel ».
La sémiotique, d’après le Dictionnaire de l’Académie française, est définie en ces termes : « Science qui étudie les systèmes de signes, de signification ». Pour faire simple, c’est une discipline scientifique qui va au-delà des mots et cherche plutôt à comprendre comment ces derniers sont porteurs de sens. Il est donc compréhensible que l’apparition de la langue schtroumpfe, qui se construit autour d’un seul mot qui peut contenir tous les sens possibles, ait retenu l’attention d’éminents sémioticiens, comme l’italien Umberto Eco. L’auteur du célèbre roman Le nom de la rose et de l’ouvrage Sémiotique et philosophie du langage a par deux fois consacré du temps pour analyser en profondeur la langue schtroumpfe et ses merveilles sémiotiques : une première fois en 1979 dans son article « Schtroumpf und Drang » pour le magazine Alfabeta et une deuxième fois en 1997 dans son ouvrage Kant et l’ornithorynque, dans lequel il revient sur le lien entre le sens et le contexte, au travers de l’exemple de la langue schtroumpfe.
Le Schtroumpf Civil
Mais les linguistes ne se sont pas contentés d’étudier la langue schtroumpfe sous tous les angles possibles, ils se sont également amusés à la pratiquer ! C’est ainsi qu’est né « Le Schtroumpf Civil » traduction du Code Civil de 1804 en langue schtroumpfe. Bien que le projet soit original, son intérêt ne se trouve que dans sa conception et elle ne présente donc aucune autre utilité que de prouver qu’elle peut exister. Le simple fait que cette traduction soit possible permet de mettre en lumière les efforts entrepris lors de la rédaction du Code Civil pour rendre les textes de lois compréhensibles, et cela même si certains termes échappent à la compréhension du lecteur de par leur complexité ou, dans le cas présent, s’ils sont remplacés par le mot « schtroumpf » et ses variantes.
Une question qui peut se poser légitimement est celle du sens assigné au mot « schtroumpf ». Si on se réfère à l’hypothèse Sapir-Whorf qui, pour faire très simple, affirme que la langue façonne notre perception du monde, que faire d’un mot qui désigne à la fois tout et rien ? Comment cette langue, en supprimant partiellement le lien entre signifiant et signifié, nous fait percevoir le monde des Schtroumpfs sous un angle qu’aucune autre œuvre de fiction ne peut adopter ?
Les Schtroumpfs, une première expérience de traduction ?
Le mot « schtroumpf » et ses nombreux dérivés ne désignent en eux-mêmes absolument rien, c’est un fait. Ce mot monosyllabique, à la construction et à la prononciation si singulières, se distingue de tous les autres mots de la langue française par son absence totale de sens. Il ne faut cependant pas voir cette absence de sens comme un vide, mais plutôt comme une page blanche sur laquelle le lecteur peut y dessiner le sens qui lui convient le mieux.
Le mot « schtroumpf » ne signifie absolument rien et en cela, il peut signifier absolument tout. C’est au lecteur de décider de son sens, en se basant sur le contexte de la phrase, sur les informations visuelles contenues sur la planche, sur son propre vocabulaire et ses propres envies. Ainsi, quel que soit la traduction que propose le lecteur lorsqu’il rencontre le mot « schtroumpf » au fil des cases, il n’aura jamais complétement tort, car c’est lui et lui seul qui donne du sens à ce mot. Et ça, c’est beau.
Mots-clés : linguistique, sémiotique, langue, contexte, schtroumpf
Sources :
SIMIAND, Guillaume. Le Schtroumpf civil. Communitas [en ligne]. 2023, 4(1), p. 4–15.
Disponible à l’adresse : https://doi.org/10.7202/1108315ar
ECO, Umberto. Schtroumpf und Drang. Alfabeta. 1979, n. 5.
PELLERIN, Thérèse. Les structures narratives, iconiques et linguistiques de Schtroumpf vert et vert Schtroumpf de Peyo (Pierre Culliford) et Yvan Delporte [en ligne]. Mémoire de maîtrise : Lettres et littérature : Université de Sherbrooke : juin 1980. Disponible à l’adresse : http://hdl.handle.net/11143/14158
MATHEY, Nicolas. Faut-il dire la schtroumpf de Babel ou la tour de Schtroumpf ? In : WordPress [en ligne] [rédigé le 1 décembre 2010]. Disponible à l’adresse : https://thomasmore.wordpress.com/2010/12/01/faut-il-dire-la-schtroumpf-de-babel-ou-la-tour-de-schtroumpf/
PEYO. Les Schtroumpfs Tome 9 : Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Éditions Dupuis, 1986.
La traduction dans le théâtre : quand les langues montent sur scène
FRIGAU-MAINNING Céline et KARSKY Marie Nadia. Traduire le théâtre. Presses Universitaires Vincennes. Paris, 2017.
Par Martin Gallet, Master TPS, promotion 2024-2025
La traduction, selon le domaine de spécialisation, requiert des compétences différentes. Un traductaire dans le secteur médical a besoin de connaissances pointues dans les sciences ; un autre dans le domaine juridique doit maîtriser de nombreuses lois et phrases dites « toutes faites » que l’on retrouve dans bien des contrats ; ou encore, pour aller plus loin, un sous-nomur doit s’imprégner des personnages de la série sur laquelle il travaille afin d’en retranscrire les émotions dans chaque réplique qu’il traduit.
En parlant de s’imprégner de personnage, permettez-moi de vous parler d’un domaine auquel la traduction n’échappe pas : le genre littéraire du théâtre !
Le théâtre, là où la fiction prend vie
Il convient tout d’abord de définir le théâtre. Le théâtre est un genre littéraire né dans l’Antiquité, en Grèce. Cet art, en Occident, tire son origine notamment des cérémonies faites en l’honneur de Dionysos, dieu de la vigne et de la fête. À cette même époque à Rome, le théâtre faisait uniquement partie des « ludi », des fêtes officielles organisées dans la cité. Dès lors, il ne cessera de prendre une place de plus en plus importante dans la vie des citoyens ; nous le constatons encore de nos jours avec les théâtres circulaires, construits en pierre dès le IIIe siècle avant notre ère.
Au fil des siècles suivants, le théâtre a su s’imposer comme un art majeur de la culture, et ce dans bien des pays. De nombreuses figures sont devenues célèbres pour leur talent d’écriture, telles que Corneille, Molière (de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin), William Shakespeare, Jean-Paul Sartre ou encore Joël Pommerat. D’autres sont également restées emblématiques pour leurs prestations. Nous pouvons évoquer Sarah Bernhardt, Sacha Guitry, Jean Marais ou encore Francis Huster. Autant dire que le théâtre a un historique pour le moins chargé !
Mais le théâtre ne serait rien sans la phase d’écriture ; et dès cette première étape, la difficulté peut se faire sentir, surtout si un auteur souhaite traduire une pièce étrangère dans sa langue maternelle.
L’aspect culturel : un premier obstacle… et pas des moindres !
La culture, ce n’est pas que le théâtre. C’est aussi une règle ; une règle qu’il convient de respecter afin que le lectorat comprenne l’ensemble de la traduction d’une pièce. La culture peut être perçue comme un véritable obstacle, notamment dès la traduction du nom de la pièce.
En effet, comment traduire le nom d’une pièce de Shakespeare en français, par exemple ?
SHAKESPEARE William. La Nuit des Rois. Éditions Flammarion. Paris, 2014.
Prenons un exemple, comme celui de Twelfth Night, une comédie écrite en 1602 par William Shakespeare. Une traduction littérale donnerait Douzième Nuit ; mais il ne s’agit que d’une référence culturelle que seule la population britannique possède. À l’époque médiévale, la douzième nuit était la dernière nuit d’un festival d’hiver (qui donnera plus tard la fête d’Halloween). Ce temps était particulièrement dédié à la fête, aux excès et au théâtre.
Mais en réalité, Twelfth Night fut traduit par Pierre Leyris en La Nuit des Rois.
Pourquoi ce choix ? L’un des noms des personnages nous en donne la réponse.
En effet, une hypothèse soutient que cette pièce aurait été commandée pour être jouée lors de la « Nuit des Rois » qu’organisait la reine Élisabeth Ière pour parachever la fin de l’ambassade du duc d’Orsino (personnage que nous retrouvons d’ailleurs dans la pièce). Le traductaire fait donc le choix d’une référence liée à l’Histoire, plutôt qu’une uniquement liée à la culture britannique et qui, par conséquent, serait difficile à comprendre pour n’importe quel lectorat d’une autre langue.
Quand la traduction apporte l’intrigue au théâtre
Le nom d’une pièce, lorsqu’il est traduit, ne fait pas toujours référence à un contexte historique. En effet, le traductaire peut faire le choix d’informer les lecteurs sur l’intrigue de la pièce grâce à la traduction du nom.
SARTRE Jean-Paul. Huis clos. Éditions Folio. Paris, 1964.
En effet, nous pouvons illustrer ce propos avec la pièce de Jean-Paul Sartre Huis clos, écrite en 1943. L’intrigue est la suivante :
« Trois personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent ensemble en Enfer. Ils sont enfermés dans un salon de style Second Empire. Ils ne peuvent s’échapper et sont condamnés à se supporter l’un l’autre. Peu à peu, ils apprendront à se connaître et comprendront qu’ils n’ont pas été mis ensemble « par hasard », mais parce qu’ils ont chacun un passé qu’ils nient. Ils feront progressivement face à la réalité, sans pour autant parvenir à s’échapper ; car l’Enfer c’est les Autres. »
Il est possible d’imaginer bien des noms pour cette pièce ; mais ici, la traduction a un sens beaucoup plus symbolique. En effet, cette pièce a pour nom No Exit en anglais (littéralement « Pas d’issue »). Sartre nous raconte trois personnages voués à passer l’éternité ensemble en Enfer et, bien qu’ils feront finalement face à leur passé et à leurs effroyables crimes, ils ne trouveront aucune issue pour s’échapper de ce salon. C’est là que nous comprenons que le choix du traductaire porte avant tout sur la situation des personnages : ils ne peuvent pas échapper à leur sort ni à leur vie.
Par conséquent, lorsqu’un traductaire fait le choix de traduire une pièce de théâtre, le nom est toujours le premier élément auquel il est confronté. Il est également un premier indice sur l’histoire de la pièce.
Le traductaire : un deuxième dramaturge ?
Le traductaire, comme nous le voyons par son travail, remplit sa tâche de repousser les frontières linguistiques et offre la possibilité à un lectorat d’accéder facilement à un texte qui n’était auparavant pas disponible dans sa langue maternelle.
Le théâtre ne déroge bien évidemment pas à la règle !
Au-delà du lectorat, le traductaire effectue une véritable réécriture et ce dès le nom de l’œuvre, comme nous avons pu le constater.
Toutefois, est-il possible de qualifier le traductaire de dramaturge lui-même ?
D’une part oui, car il est de son devoir de transposer les références propres à un pays vers la langue dans laquelle il rédige son travail. Il lui faut donc se renseigner, effectuer de nombreuses recherches et être capable de trouver un nom suffisamment original pour captiver le lectorat (comme un dramaturge), tout en restant le plus proche possible du texte d’origine.
D’autre part, nous pouvons constater que le rôle du traductaire est fondamentalement différent de celui du dramaturge. Le traductaire n’est pas à l’origine-même de la pièce : il ne fait qu’en donner une « 2e version » en changeant la langue du texte. C’est en cela que nous pouvons affirmer que le traductaire, par son travail, n’est pas un dramaturge à proprement parlé. D’ailleurs, si l’on en croit le philosophe José Ortega y Gasset, « Traduttore, traditore », autrement dit « traduire, c’est trahir ». Trahir le sens, trahir l’esthétique première d’une œuvre ; mais en réalité, il la modifie pour la faire correspondre le mieux possible au lectorat de sa langue maternelle.
Néanmoins, la tâche du traductaire est avant tout de transmettre un message, un texte ou une œuvre dans une autre langue, affaiblissant ainsi les barrières linguistiques et ouvrant ses écrits à un lectorat toujours plus large.
Pour conclure, le théâtre et la traduction nécessitent des outils plus ou moins similaires : de la créativité, des règles, des références culturelles et historiques et de l’authenticité.
Sur ce, rideau !
Mots-clés : Traduction / Théâtre / Culture / Histoire / Linguistique / Transmission
Pour aller plus loin :
VINUESA-MUÑOZ Cristina. « La traduction théâtrale : un enjeu collectif, une méthode. ». Synergies Espagne. Valence, 2017.
URL : https://gerflint.fr/Base/Espagne10/Vinuesa.pdf
FRIGAU-MAINNING Céline et KARSKY Marie Nadia. Traduire le théâtre. Presses Universitaires Vincennes. Paris, 2017.
URL : https://shs.cairn.info/traduire-le-theatre–9782842926045?lang=fr
Théâtre. (2025, 24 janvier). Dans Wikipédia.
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
MAURIN Anne. “La traduction théâtrale et ses enjeux dramaturgiques. ». HAL Open Science. 2013.
URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00835578/document
Le pouvoir du glossaire : l’allié indispensable du traducteur
Par Gaurishma Suneja, Master TPS, promotion 2023-2025.
Vous devez traduire quarante pages d’un document technique sur les panneaux solaires, cela semble effrayant, n’est-ce pas ? Mais avec les bons outils, c’est bien plus simple qu’il n’y paraît. Que vous soyez novice ou déjà professionnel dans le domaine de la traduction, qu’il s’agisse d’énergie solaire, de dispositifs médicaux ou d’ingénierie industrielle, un indispensable pour réussir est le glossaire. Cet outil magique vous aide à rester précis, cohérent et à livrer des traductions dignes des attentes les plus élevées. Vous n’avez pas encore intégré un glossaire dans votre méthode de travail ? Pas de panique ! Après avoir parcouru cet article, vous en comprendrez l’importance et serez prêt à l’adopter.
Qu’est-ce qu’un glossaire de traduction ?
Saviez-vous que le mot « glossaire » puise ses origines dans le latin glossarium, désignant à l’époque un dictionnaire expliquant des termes rares ou anciens ? Introduit dans la langue française en 1585 sous la forme de « recueil de gloses », il a progressivement gagné en popularité au XVIIᵉ siècle. Depuis, le glossaire s’est imposé comme un outil précieux pour rendre accessibles les termes complexes — une mission qui n’a rien perdu de sa pertinence, surtout dans le domaine de la traduction.
Dans un projet de traduction, le glossaire devient bien plus qu’une simple liste de mots : c’est un guide structuré regroupant des termes spécifiques, définitions et abréviations propres à un secteur donné. Pour un traducteur, c’est un véritable passeport vers la précision et la fluidité. L’objectif est simple : maîtriser les particularités de votre domaine afin que la traduction soit à la fois fidèle et claire.
Pourquoi utiliser un glossaire ? Quels avantages pour le traducteur ?
L’utilisation d’un glossaire est essentielle dans le processus de traduction. Prenons un exemple concret : en droit, le terme « meuble » ne désigne pas seulement les objets que l’on utilise au quotidien, comme des canapés ou des bureaux. Il se divise en deux catégories : les meubles corporels et les meubles incorporels. Les meubles corporels sont des biens qui peuvent être déplacés, comme une voiture, du mobilier, de l’argent, voire des animaux. Quant aux meubles incorporels, ce sont des droits, comme les parts de société ou les droits d’auteur.
Un autre exemple dans le domaine de la traduction médicale : en anglais, le terme « condition » d’un patient ne correspond pas à « condition » en français, mais plutôt à son « état ». De plus, en anglais, le corps humain est souvent comparé à une machine, ce qui conduit à l’utilisation de termes comme « damages », qui en français se traduirait par « altérations », « troubles » ou « lésions ». Ces différences peuvent prêter à confusion, mais avec un glossaire bien défini, chaque terme trouve sa place et son sens dans le contexte spécifique, facilitant ainsi la traduction.
Les avantages du glossaire pour le traducteur :
- Cohérence terminologique: Un glossaire, c’est l’outil clé pour garder des termes uniformes du début à la fin d’un projet. Il assure une traduction cohérente, surtout lorsque vous travaillez sur de gros volumes de texte ou en équipe avec plusieurs traducteurs.
- Réduction du temps de recherche : Le glossaire, c’est un vrai gain de temps. Il offre une référence rapide, évitant au traducteur de chercher sans arrêt des termes techniques ailleurs.
Améliorer la gestion des glossaires avec les outils de TAO
Aujourd’hui, les logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO) rendent la création et la gestion des glossaires plus simples et plus efficaces que jamais. Ces outils permettent d’ajouter facilement de nouveaux termes au fur et à mesure du projet, de sorte que chaque traducteur peut accéder à une base de données constamment mise à jour. Le résultat ? Une cohérence totale dans la traduction, peu importe la taille du projet.
Quels avantages pour le client ?
- Gain de temps et de coûts: La gestion d’un glossaire permet une meilleure efficacité, réduisant ainsi les délais de livraison et les coûts du projet.
- Transmission fidèle du message: En utilisant un glossaire, le traducteur assure une interprétation fidèle des termes techniques du client, garantissant que le message reste clair.
- Renforcement du niveau de confiance: Lorsque le client perçoit que son projet est géré de manière professionnelle, cela renforce le lien de confiance et favorise une collaboration à long terme.
Comment créer un bon glossaire de traduction ?
Un glossaire de traduction, c’est comme un petit dictionnaire personnel pour chaque projet. Il peut être organisé de façon simple, souvent sous forme de liste alphabétique pour une consultation rapide, ou bien dans un tableur Excel pour plus de flexibilité.
Chaque terme ou expression y est soigneusement référencé :
- dans sa langue source ;
- sa traduction exacte ;
- son abréviation si nécessaire ;
- les variations possibles de traduction vers les langues cibles.
Enfin, chacun peut personnaliser son glossaire en fonction de ses besoins. Par exemple, on peut y ajouter des champs pour des définitions, des sources ou des notes spécifiques. Chacun a sa propre méthode de travail, et c’est cela qui rend le glossaire encore plus adapté à chaque projet.
Conclusion
Alors, pourquoi ne pas sauter le pas et utiliser un glossaire dès maintenant ? Que vous soyez traducteur, chef de projet ou client, le glossaire devient vite un allié incontournable. Il simplifie le travail, fait gagner du temps et assure la qualité. C’est la clé pour des projets réussis, à chaque fois.
Mots clés : glossaire, traduction, technique
Pour aller plus loin :
Gouadec (Daniel) (dir.), Actes des universités d’été et d’automne en terminologie de l’Université de Rennes II, En bons termes, numéros spéciaux, La Maison du Dictionnaire, 1993-2000.
URL :https://shs.cairn.info/revue-langages-2005-1-page-14?lang=fr&tab=bibliographie
Acolad. (2024) « Comment les glossaires et les mémoires peuvent vous faire capitaliser sur vos projets de traduction ? »
Laur, A. (2012, July 17). « Existe-t-il un langage juridique ? » Village De La Justice,
URL : https://www.village-justice.com/articles/Existe-langage-juridique,12568.html?
Jahan, P. (2023, November 7). La terminologie dans la traduction médicale. IPAC Traductions.
URL : https://www.ipac-traductions.com/blog/terminologie-en-traduction-medicale/
Ces erreurs de traduction qui ont marqué l’Histoire : quand un mot peut tout changer.
Par Stecy Jodar, Master TPS, promotion 2023-2025.
Nous le savons bien, la traduction est bien plus qu’une simple transposition de mots d’une langue à l’autre. Elle peut, si elle est mal effectuée, provoquer des malentendus, des tensions diplomatiques et même des guerres. À travers les siècles, l’Histoire regorge d’erreurs de traduction qui ont entraîné des conséquences importantes. Des Guerres mondiales à la Guerre froide, retour sur quelques incidents où une mauvaise interprétation ou traduction d’un mot a marqué le cours de l’Histoire contemporaine.
Le « télégramme Zimmermann » et l’entrée en guerre des États-Unis (1917)
En janvier 1917, le ministre des Affaires étrangères allemand, Arthur Zimmermann, envoya un télégramme secret au gouvernement mexicain, pour lui proposer une alliance contre les États-Unis, en échange de la restitution de territoires comme le Texas et l’Arizona. Ce télégramme, intercepté par les services secrets britanniques, fut mal traduit. Le terme “soutien militaire” fut interprété de manière plus menaçante qu’il ne l’était en réalité. La traduction de ce message a mis en alerte les États-Unis, précipitant leur entrée en guerre contre l’Allemagne en avril 1917.
Hiroshima
Avec le recul, on a toutes les raisons de croire que le destin d’Hiroshima aurait été la conséquence d’une erreur de traduction. À l’issue de la Conférence de Potsdam, en juillet 1945, les Alliés adressèrent un ultimatum au premier ministre japonais en exigeant la capitulation du Japon. À Tokyo, les journalistes pressèrent le premier ministre Kantaro Suzuki de leur communiquer la réaction des autorités. Dans sa réponse, il utilisa le mot polysémique mokusatsu pour dire que son gouvernement « s’abstenait de tout commentaire pour le moment ». Les traducteurs lui donnèrent le sens de « traiter avec un mépris silencieux », « ne pas tenir compte » (to ignore), ce qui faisait dire au premier ministre : « Nous rejetons catégoriquement votre ultimatum. » Irrités par le ton arrogant de cette réponse, les Américains y virent une réaction dédaigneuse. Dix jours plus tard, ils larguaient leur bombe sur la ville japonaise.
« We will bury you » de Khrouchtchev (1956)
L’une des erreurs de traduction les plus marquantes pendant la Guerre froide est celle de la déclaration de Nikita Khrouchtchev en 1956. Le leader soviétique avait prononcé en russe : “We will bury you”, une phrase traduite littéralement par ses interlocuteurs anglais et interprétée comme une menace nucléaire. En réalité, Khrouchtchev faisait référence à la supériorité idéologique du socialisme sur le capitalisme. Toutefois, la traduction brutale de cette phrase a déclenché une forte réaction dans les pays occidentaux, alimentant la paranoïa et la méfiance pendant la Guerre froide, ce qui renforça l’hostilité entre l’Est et l’Ouest.
« Ich bin ein Berliner » et le quiproquo de Kennedy (1963)
En voulant exprimer sa solidarité avec la ville partagée par le mur, John F. Kennedy, en 1963, déclara dans son discours emblématique : “Ich bin ein Berliner”. Cependant, le mot Berliner désigne aussi une pâtisserie, ce qui provoqua un certain amusement parmi les Berlinois. Bien que cette erreur n’ait entraîné aucune conséquence diplomatique majeure, elle montre à quel point une petite erreur linguistique peut changer la manière dont un discours est perçu, même lorsqu’il est prononcé dans un contexte aussi solennel.
Conclusion
Ces exemples illustrent bien comment une simple erreur de traduction peut entraîner des conséquences profondes sur l’Histoire. Que ce soit pour déclencher une guerre, influencer des négociations ou intensifier des tensions géopolitiques, les mots traduits avec imprécision ont souvent fait basculer des événements. Dans le monde complexe de la diplomatie internationale, la traduction n’est pas seulement un art, c’est aussi une question de maintien diplomatique voire de survie politique.
Mots-clés : erreurs de traduction, guerres et traduction, géopolitique et langage
Pour aller plus loin :
LADMIRAL, Jean-René. L’erreur de traduction : Origines et conséquences. Paris : Éditions de Minuit, 1995.
British Council. Ressources sur les malentendus diplomatiques liés à la traduction.
COHEN, Roger. La guerre des mots : La diplomatie et ses faux-semblants. Paris : Éditions Grasset, 2003.
Les erreurs de traduction dans l’Histoire. Journal of International Affairs, vol. 67, n° 2, 2021, pp. 105-120.
DELISLE, Jean. Les erreurs de traduction à travers l’Histoire. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2007.
QUAND LE SEPTIÈME ART S’INTÉRESSE À LA TRADUCTION
Par Clémence Baux, Master TPS, promotion 2023-2025
Les métiers de traducteur et d’interprète sont parfois mis en scène dans des œuvres cinématographiques. Alors que ces représentations mettent un véritable coup de projecteur sur ces professions, celles-ci sont-elles fidèles à la réalité ?
Cette publication va tenter de voir au-delà des clichés et des paillettes, et va essayer de comparer différentes visions des métiers de la traduction à la réalité :
- la vision cinématographique: en s’appuyant les films L’Interprète (2005) et Les Traducteurs (2019) ;
- la vision du grand public: en analysant les réponses d’un questionnaire rempli par des proches qui n’ont aucun lien avec la traduction ;
- la réalité: en utilisant mon expérience d’étudiante et les informations qui m’ont été données au cours de ma formation.
SÉQUENCE 1. Synopsis des deux films.
L’Interprète se concentre, comme son nom l’indique, sur une interprète à l’ONU qui croit entendre des hommes planifier un assassinat dans une langue africaine. Un agent du FBI va être chargé de l’enquête : l’interprète dit-elle la vérité ? Ou joue-t-elle sur les mots ?
Des traducteurs sont isolés dans une maison ressemblant à un bunker pour traduire le dernier tome d’un livre à succès. Alors qu’ils sont tous coupés du monde extérieur, les dix premières pages du livre sont publiées sur internet. Un pirate anonyme menace de dévoiler tout le livre si une rançon n’est pas payée. Mais qui peut bien être à l’origine de ce chantage ?
SÉQUENCE 2. Comparaison des différentes visions.
- La traduction : un métier de l’ombre ?
Sur ce point, tout le monde est sur la même longueur d’onde.
- La vision cinématographique: dans Les Traducteurs, de nombreuses références sont réalisées à ce sujet et de nombreux clichés sont représentés. Par exemple, l’éditeur du livre à succès rappelle souvent que les traducteurs ne sont que des traducteurs, ils sont enfermés contre leur volonté mais ne peuvent rien dire car ils sont… traducteurs.
- La vision du grand public: parmi les personnes qui ont répondu aux questionnaires, un grand nombre souligne que ce métier n’est pas mis avant. Ils expliquent qu’ils ne prêtent pas attention au nom du traducteur dans les œuvres littéraires, son nom étant souvent écrit en tout petit et peu souvent sur les couvertures du livre. Pour aller plus loin, les seules personnes qui connaissent un traducteur me connaissent moi (étudiante).
- La réalité: le traducteur n’est jamais véritablement mis en avant alors qu’il est présent au quotidien. Sans traduction, aucun pont entre les différentes langues et cultures ne peut être réalisé, elle est alors essentielle.
- Traducteurs et interprètes : hommes ou femmes ?
- La vision cinématographique: les deux films exposent deux idées différentes. Dans L’Interprète, la femme est mise en avant, et on peut voir à quelques reprises qu’elle travaille majoritairement avec d’autres femmes. Pourtant, dans Les Traducteurs, dans un groupe de neuf personnes il y a quatre femmes et cinq hommes.
- La vision du grand public: tout le monde a répondu qu’en majorité les traducteurs étaient des femmes !
- La réalité: selon une estimation de la Société Française des Traducteurs les femmes sont majoritaires : 80 % de femmes contre 20 % d’hommes.
- Le métier d’interprète
- La vision cinématographique: le métier d’interprète est représenté dans L’Interprète comme essentiel à la résolution d’une enquête. On voit à plusieurs reprises dans des échanges en langue africaine que l’interprète à une longueur d’avance dans l’enquête car elle est la seule à manier cette langue. Ce métier est aussi symbole d’excellence car pratiqué à l’ONU.
- La vision du grand public : les personnes interrogées dans le questionnaire ne savent finalement pas réellement comment travaille un interprète. Ils pensent en majorité qu’un interprète travaille seul pour ne pas être influencé par une vision ou une interprétation différente. Enfin, l’interprétation est perçue comme « un niveau au-dessus de la traduction ».
- La réalité: un interprète peut travailler seul, mais pas toujours. Le terme concabin désigne des interprètes qui travaillent dans la même cabine, parfois en binôme. L’interprétation est une activité qui demande de la précision, et qui peut demander beaucoup d’énergie : travailler en binôme permet d’assurer une interprétation de qualité dans la durée. Finalement, la traduction et l’interprétation demandent des compétences différentes, qui ne peuvent être comparées : aucune activité n’est meilleure que l’autre.
- Les méthodes de travail
- La vision cinématographique: enfermés dans leurs bunkers, les traducteurs du film éponyme n’ont pas accès à internet. Ils sont entourés d’une bibliothèque pour les aider, et de dictionnaire. Leur plus grand atout semble être leur cerveau, comme s’ils n’avaient pas besoin de plus.
- La vision du grand public: dans l’inconscient collectif, les outils utilisés sont assez flous et différentes réponses montrent que ce métier, bien qu’il soit omniprésent dans nos sociétés, demeure peu connu. On peut citer en majorité que selon le grand public, un traducteur utilise :
- des dictionnaires ;
- un papier et un stylo ;
- un ordinateur ;
- sa sensibilité ainsi que ses connaissances linguistiques, sa créativité, etc.
- La réalité: il existe autant de méthodes de travail que de traducteurs. Un traducteur peut utiliser des outils complètement inconnus pour le public : des glossaires, des bases terminologiques, des logiciels de traduction assistée par ordinateur (TAO), etc. Le papier et le stylo sont plutôt remplacés par un ordinateur, et les connaissances d’un traducteur ne sont plus uniquement dans sa tête.
SÉQUENCE 3. Clap de fin.
Bien que la traduction soit présente au quotidien, ses représentations ne sont pas toujours fidèles. En effet, toutes les interprètes ne sont pas des héroïnes qui peuvent empêcher un assassinat ! Ces films offrent deux perceptions distinctes : l’interprétation est une activité liée à l’excellence, tandis que la traduction est une profession ingrate où le traducteur est souvent invisible. Ces métiers mériteraient une meilleure mise en lumière afin d’être plus connus par le grand public, qui y a recours au quotidien sans même s’en rendre compte.
Mots clés : traduction, cinéma, fidélité.
Filmographie :
Pollack, S (Réalisatrice). (2005). The Interpreter [Film]. Universal Pictures.
Roinsard, R. (Réalisateur). (2019). Les Traducteurs [Film]. Trésor Films.
Rire ou traduire, faut-il choisir ?
Par Mariane Schollaert, Master TPS, promotion 2023-2025
L’humour représente l’un des défis majeurs de la traduction. Il se manifeste sous plusieurs angles, comme les jeux de mots, les références culturelles ou simplement le contexte, et peut compliquer le passage d’une langue à une autre. Pour que sa traduction soit réussie, le traducteur doit alors s’armer d’un excellent bagage culturel et linguistique et faire preuve d’ingéniosité, car la recréation est souvent
nécessaire. Lorsque le traducteur doit adapter son texte, il doit essayer de préserver une partie de la plaisanterie originale. Par ailleurs, plusieurs paramètres sont à prendre en compte comme le public cible, le contexte, le support utilisé et parfois la prononciation.
Les jeux de mots : véritable cauchemar du traducteur
Ce sont souvent eux qui nous viennent à l’esprit lorsque l’on pense à l’humour. Dans leurs cas, la traduction littérale est la plupart du temps impossible, car l’effet ne sera pas celui escompté et la phrase peut même en devenir incompréhensible. Plusieurs options sont alors possibles : créer son propre jeu de mots ou simplement omettre la traduction volontairement. Ce qui est le cas dans la série “Friends” lorsque Ross confond “chimie” et “Chianti” (un type de vin) à cause de leur sonorité similaire ; beaucoup de versions sous-titrées ont traduit ce jeu de mot littéralement, perdant alors tout effet humoristique. Toutefois, certains traducteurs, comme ceux de la saga Harry Potter, se sont
montrés inventifs lors de la traduction. Par exemple, “Neville Longbottom” a été traduit par “Neville Londubat” ou encore “Sorting hat” par le “Choixpeau” ; une traduction meilleure que l’original !
Les références culturelles : la créativité mise à l’épreuve
Les blagues basées sur la culture d’un pays ou d’une région sont souvent les plus appréciées. Cependant, seule une minorité de personnes peuvent les comprendre ; il est alors nécessaire de les adapter. Pour cela, le traducteur doit impérativement être à la page concernant l’actualité du pays cible. Par exemple, dans “Astérix : Le domaine des Dieux”, Abraracourcix dit “je vous ai compris” en référence au général de Gaulle. Dans la version anglaise, cette phrase a été remplacée par “Yes you can”, prononcé par Barack Obama. Pour reprendre l’exemple de “Friends”, un calembour a été fait sur les crumpets, un biscuit américain. Monica dit “Je pensais que c’était un muffin.”, or les muffins
et les crumpets ne se ressemblent pas du tout, et ça, le public français ne le sait pas. De plus, dans la version française, “crumpet” a été remplacé par “muffin”, ce qui est donc incompréhensible.
Ce qu’il faut retenir
En définitive, la traduction de l’humour n’est pas seulement question de mots, mais un véritable art qui nécessite créativité et ingéniosité. Les traducteurs doivent user de stratagèmes audacieux et d’adaptations pour parvenir à conserver le niveau et le type d’humour employé, mais aussi fournir une traduction capable de créer un effet similaire chez le lecteur cible. Même si la traduction de l’humour reste un défi complexe pour le traducteur, elle n’en est pas moins impossible ; c’est d’ailleurs le moteur de la transcréation dans de nombreux domaines. La liste des questions au sujet de la traduction de l’humour est encore longue. Par exemple, que doit-on faire des blagues de mauvais goût ?
Mots-clés : humour, blague, jeux de mots, traduction
Pour aller plus loin :
“Le sous-titrage de ‘Friends’ influence-t-il la compréhension des blagues culturelles ?”, Culture Série et littérature transcrite, 10 mars 2024
https://www.litteratureetculture.com/titrage-friends-influence-comprehension-blagues-culturelles.html
Marina Ilari, “L’humour, casse-tête des traducteurs”, Le courrier de l’UNESCO, 30 mars 2022
https://courier.unesco.org/fr/articles/lhumour-casse-tete-des-traducteurs
“Traduire les contenus humoristiques, un exercice pas si amusant…”, Traduc, 12 juillet 2022
https://traduc.com/blog/traduction-humoristique/
La traduction de chansons : un défi entre fidélité et créativité
Par Thomas Calleau, Master TPS, promotion 2023-2025
La traduction de chansons représente une tâche exigeante qui va bien au-delà du simple transfert de mots d’une langue à une autre. Contrairement à la traduction de textes classiques, traduire une chanson implique une balance délicate entre le respect de l’intention originale de l’auteur, les contraintes linguistiques, et les particularités culturelles. À cela s’ajoutent des exigences musicales, telles que le rythme, la mélodie et les rimes, qui imposent des limites uniques à la traduction.
Les exigences musicales : une contrainte pour le traducteur
L’un des aspects les plus difficiles de la traduction d’une chanson est l’obligation de s’adapter à sa structure musicale. Contrairement à un poème, une chanson est liée à un rythme précis et des mélodies préexistantes.
Si la traduction produit un texte plus long ou plus court, cela peut briser l’équilibre musical et rendre le résultat peu naturel à l’écoute. De plus, certaines langues sont plus concises que d’autres. L’anglais, par exemple, a une grande capacité de concision par rapport au français. Une phrase comme « I love you » peut devenir « Je t’aime de tout mon cœur » en français, ce qui perturbe le rythme initial.
La rime : une prison poétique
Un autre défi majeur dans la traduction de chansons est la rime. Dans de nombreux genres musicaux, la rime joue un rôle crucial pour créer une esthétique agréable et mémorable. Cependant, il est rare que les mots rimant dans une langue trouvent des équivalents rimés dans une autre.
Prenons la chanson classique de Charles Aznavour, La Bohème :
Je vous parle d’un temps / Que les moins de vingt ans / Ne peuvent pas connaître…
Traduire ces vers en anglais tout en conservant la rime et le sens est presque impossible. Un traducteur pourrait choisir de privilégier le sens :
Let me tell you of a time / That those under twenty / Could never understand…
Cependant, ce choix élimine complètement les rimes. D’un autre côté, une version qui insiste sur la rime pourrait altérer le message :
I’ll recall a time / Of a youthful prime / Lost to younger hearts…
Chaque approche implique des compromis, forçant le traducteur à choisir entre l’esthétique sonore et la fidélité au contenu.
Le transfert culturel : quand les références s’égarent
Les chansons ne sont pas de simples assemblages de mots et de mélodies : elles portent également les empreintes culturelles de leurs créateurs. Les références historiques, géographiques ou idiomatiques peuvent être incompréhensibles ou inappropriées pour un public étranger.
Prenons l’exemple de Style, un morceau connu de Taylor Swift. Une ligne emblématique de cette chanson est :
You’ve got that James Dean daydream look in your eye.
Cette phrase fait référence à James Dean, une icône de la culture américaine des années 1950. En français, James Dean risque de ne pas susciter une telle résonance émotionnelle. Une traduction littérale, comme :
Tu as ce regard rêveur à la James Dean dans les yeux,
est fidèle mais risque de sembler peu pertinente. Une adaptation plus universelle pourrait remplacer James Dean par une figure plus connue localement ou alors reformuler totalement :
Tu as ce regard rêveur, plein d’audace et de mystère.
Un art à part entière
La traduction de chansons ne se limite pas à un simple exercice linguistique. Elle force les traducteurs à faire des choix difficiles, oscillant entre fidélité au texte, respect de la musique et adaptation au public cible.
En fin de compte, une traduction réussie est celle qui parvient à capturer l’essence d’une chanson tout en lui offrant une nouvelle vie dans une autre langue. C’est une tâche ingrate, souvent invisible pour le public, mais essentielle pour connecter les cultures et permettre aux mélodies et aux messages de traverser les frontières.
Mots-clés : traduction, chanson, contraintes, rime
Pour aller plus loin :
PRUVOST, Céline, « Traduire la chanson, un révélateur de sa spécificité », Vox Popular, 2017, Poésie et chanson de la France à l’Europe, 1/2, pp.168-186. hal-03537101f https://upicardie.hal.science/hal03537101/document
« Une chanson traduite peut-elle obtenir le même succès que sa version initiale ? », International, 24 janvier 2022, https://www.tradonline.fr/blog/une-chanson-traduite-peut-elle-obtenir-le-meme-succes-que-sa-version-initiale/
LALIBERTÉ Michèle, « Comment traduire la chanson populaire? », Circuit, 2019, https://www.circuitmagazine.org/dossier-143/comment-traduire-la-chanson-populaire
Journée Mondiale de la Traduction 2024 : célébrons l’Art de la Traduction.
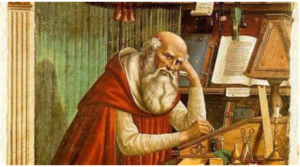
Par Lucie Nonnotte, Master TPS, promotion 2023-2025
Le 30 septembre, à l’occasion de la Journée mondiale de la traduction, nous rendons hommage à un métier qui dépasse les simples échanges linguistiques pour incarner un véritable pont entre les cultures. Cette journée, marquée par la Saint Jérôme, saint patron des traducteurs, souligne l’importance cruciale des spécialistes des langues dans la promotion de la paix, de la compréhension et du développement à l’échelle mondiale.
Un Événement Significatif
Instituée par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 71e session, la Journée mondiale de la traduction est l’occasion de reconnaître le rôle essentiel des traducteurs et interprètes dans le rapprochement des nations. Leur travail permet de faciliter le dialogue interculturel, d’améliorer la coopération internationale et de renforcer la sécurité. Célébrer cette journée, c’est également rappeler à tous l’importance de la diversité linguistique et culturelle dans le monde.
Qui est Saint Jérôme ?
Le choix du 30 septembre n’est pas anodin. Ce jour marque le décès de Saint Jérôme, un traducteur dont l’oeuvre majeure, la Vulgate, a marqué l’histoire de la traduction. Né en l’an 347 à Stridon, Jérôme a consacré 34 années de sa vie à traduire la Bible du grec au Latin, une tâche qui a non seulement influencé la théologie chrétienne mais a également établi des normes pour la traduction littéraire. En tant que saint patron des traducteurs, il incarne les valeurs de savoir et de dévouement à la compréhension mutuelle, des qualités que nous célébrons en ce jour.
Thème de l’Année 2024
Chaque année, cette journée est marquée par un thème spécifique qui aborde des enjeux contemporains dans le domaine de la traduction. Par exemple, le thème de 2024 était « La traduction, un art qui mérite d’être protégé : droits moraux et matériels pour les langues autochtones ». Cette thématique met en lumière les défis éthiques liés aux droits d’auteur, à la collecte de données et à l’utilisation des oeuvres traduites. Elle pose également la question de la reconnaissance des traductions en tant qu’oeuvres créatives originales, protégées par le droit d’auteur.
Célébrations et Activités
La Journée mondiale de la traduction est célébrée par divers événements à travers le monde. Des conférences et des séminaires permettent aux professionnels de partager leurs expériences et d’aborder des enjeux contemporains, tandis que des ateliers pratiques offrent des formations sur des compétences spécifiques. Les réseaux sociaux sont utilisés pour des campagnes de sensibilisation, incluant des témoignages et des infographies. Certaines institutions organisent des projections de films et des lectures de textes traduits pour mettre en valeur le travail des traducteurs. Enfin, des concours et des prix récompensent l’excellence dans le domaine, stimulant ainsi l’engagement et la créativité.
En somme, la Journée mondiale de la traduction est bien plus qu’une simple célébration, c’est un moment crucial pour reconnaître le rôle multifacette des traducteurs dans notre société moderne, tout en soulignant l’importance de la compréhension interculturelle et de la protection des langues et des cultures à travers le monde.
Mots clés : traduction, Saint-Jérôme, diversité culturelle
Pour aller plus loin
Journée mondiale de la traduction 2024. Fédération internationale des traducteurs. https://fr.fit-ift.org/journee-mondiale-de-la-traduction/
Journée internationale de la traduction. Nations unies https://www.un.org/fr/observances/international-translation-day#:~:text=Par%20sa%20r%C3%A9solution%2071%2F288,la%20compr%C3%A9hension%20et%20du%20d%C3%A9veloppement.
Journée internationale de la traduction. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_de_la_traduction
Jérôme de Stridon. Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_de_Stridon
Qui est saint Jérôme, le saint patron des traducteurs et des traductrices ? Les univers du livre actualitté. https://actualitte.com/article/102620/archives/qui-est-saint-jerome-le-saint-patron-des-traducteurs-et-des-traductrices
Traduction ou réécriture ?
Le rôle créatif du traducteur dans le domaine littéraire
Par Lili Giraud, Master TPS, promotion 2023-2025
Tout le monde a déjà entendu dire que la traduction littéraire offre plus de créativité, et même de liberté, que d’autres branches du métier. Cette affirmation est due aux tournures de phrases, aux choix en ce qui concerne le vocabulaire, mais aussi à une certaine idée que le traducteur peut être moins fidèle au texte source tant qu’il respecte certaines contraintes de style et qu’il arrive à communiquer le message présent dans l’original.
Sachant que chaque texte et type de texte présente des restrictions spécifiques, cette « liberté » donnée aux traducteurs littéraires ne semble pas toujours être une difficulté comparée à d’autres, comme la nécessité de fidélité dans les documents officiels ou la limite de caractères dans le sous-titrage. Elle présente cependant des défis qui lui sont propres.
Une traduction littéraire devient une œuvre de l’esprit, ce qui signifie qu’elle est protégée comme l’original. Alors, non seulement le traducteur reçoit-il des droits d’auteur, mais il devient aussi juridiquement l’auteur de cette version. Dans l’image qu’on se fait des traducteurs littéraires, ils peuvent aussi être considérés comme auteurs pour des raisons différentes de leur statut officiel. Si on parle de livres, le style, les tournures et parfois la longueur des phrases ne sont pas les seuls obstacles sur la route des traducteurs.
Dans la fiction, notamment, il peut y avoir des références culturelles, qui sont indéniablement compliquées à retranscrire clairement dans une autre langue, mais aussi pour un public dont la culture peut être plus ou moins différente.
En plus de cela, cependant, certains auteurs créent entièrement des endroits, des noms, des univers, des mots, et même des concepts. Alors, inventer un équivalent à un concept créé de toute pièce par l’auteur original tout en respectant ses sources, inspirations, ainsi que le sens qu’il a voulu lui donner et le message qu’il fait passer à travers est un défi important.
La science-fiction et la fantaisie (aussi appelé merveilleux, de l’anglais « fantasy ») sont particulièrement connues pour ces difficultés qui demandent des efforts époustouflants. En créant des mondes, des langues et des mythologies qui n’existent que dans leurs œuvres, ces auteurs donnent aux traducteurs une mission qui peut paraitre comme une liberté créative, mais qui en réalité se révèle tout aussi codifiée que dans n’importe quel autre domaine.
Dans ces univers, on peut citer l’exemple de l’onomastique (l’étude des noms propres, surtout l’anthroponymie et la toponymie, les noms de personnes et de lieux), qui tient une place importante : les noms propres peuvent contenir plus d’information que n’importe quel dialogue. Les noms des personnages, par exemple, en plus d’être inspirés d’événements historiques ou de références littéraires qui peuvent être propres à une culture, peuvent définir leur histoire. On peut alors citer une écrivaine qui apporte une importance immense au choix de ses noms, celui de Suzanne Collins pour la saga Hunger Games. Si vous connaissez le soldat Lucius Aelius Sejanus, le roi romain Coriolan (Coriolanus en anglais, qui est aussi le nom d’une pièce de Shakespeare), ou le poème « Lucy Gray » de William Wordsworth, vous pouvez prédire le sort des trois personnages qui leur doivent leur nom.
Spoiler alert : entre un soldat exécuté pour trahison, un empereur exilé de son propre territoire qui s’allie avec l’ennemie pour reprendre son trône, et une jeune fille qui disparait mystérieusement et n’est jamais retrouvée, l’intrigue du livre La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est contenue dans le nom de ses personnages.
Il reste alors à savoir si tous les publics comprendront ces références. Quelle serait alors la priorité ? Une source fixe, ou la compréhension du lecteur ? Ces interrogations pourraient entrer dans le débat continuel qui oppose sourciers et ciblistes, qui fait partie intégrante de la réflexion du traducteur littéraire.
Mots clés : traduction littéraire, créativité, contrainte
Pour aller plus loin :
Lance Hewson (décembre 2017), « Les paradoxes de la créativité en traduction littéraire », Meta, La traduction littéraire comme création, Volume 62, numéro 3, p. 501–520 : https://doi.org/10.7202/1043945ar
Judith Woodsworth (1988), « Traducteurs et écrivains : vers une redéfinition de la traduction littéraire », TTR : traduction, terminologie, rédaction, Volume 1, numéro 1, p. 115–125 : https://doi.org/10.7202/037008ar
Gauthier Grüber (mars 2020), « Onomastique et plaisir de la lecture », Acta fabula, vol. 21, n° 3, Notes de lecteur : https://10.58282/acta.12685
Margit Raders, Rafael Martín-Gaitero (1994), IV Encuentros Complutenses en Torno a la Traducción, 24-29 de febrero de 1992, Universidad Complutense de Madrid. Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, Editorial Complutense, p. 105-117 : https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=IPdf5DmFFz4C&oi=fnd&pg=PA105&dq=créativité+en+traduction+littéraire&ots=SNu4e5c9cq&sig=y4rm40VHPWXczVdxKVvINyFIOxg&redir_esc=y#v=onepage&q=créativité%20en%20traduction%20littéraire&f=false
La littérarité d’une oeuvre : le défi ultime pour un traducteur littéraire ?
Par Orlane Raumel, Master TPS, promotion 2023-2025
Cette publication est une synthèse de l’article scientifique suivant : Enjeux de la traduction : problèmes du traducteur pour rendre la littérarité d’une oeuvre, extrait de l’ouvrage intitulé Le français et les langues d’Europe de Françoise Argod-Dutard.
Cet article explore les défis auxquels un traducteur littéraire est confronté lorsqu’il s’efforce de préserver la littérarité d’une oeuvre, c’est-à-dire les caractéristiques littéraires spécifiques d’une oeuvre originale, lors de sa traduction dans une autre langue. La traduction littéraire ne se limite pas à une simple transposition des mots d’une langue à une autre, mais exige un travail d’interprétation et de recréation qui prend en compte des éléments comme le style, la structure, les sonorités et les connotations culturelles propres à la langue source.
Définition de « littérarité »
Le concept de littérarité fait référence à l’ensemble des caractéristiques qui confèrent à un texte son statut littéraire : son style, son esthétique, ses figures de style et sa richesse sémantique, notamment. Le texte littéraire se distingue ainsi par une dimension artistique qui transcende le contenu informatif ou factuel.
Une pièce de théâtre, un roman ou un poème, visant à stimuler l’imaginaire du lecteur, ne peut être réduit à une suite d’idées ou d’évènements comme une simple notice explicative. C’est l’usage particulier de la langue dans ce type de texte qui en fait une oeuvre d’art. Le traducteur se retrouve alors face au défi complexe de rendre cette littérarité dans une autre langue, tout en tenant compte des spécificités linguistiques et culturelles de cette dernière.
Défis linguistiques
Un des premiers obstacles auxquels doit faire face le traducteur littéraire réside dans les différences structurelles entre les langues. Certaines langues peuvent avoir des constructions grammaticales, des nuances de vocabulaire ou des figures de style qui n’ont pas d’équivalents directs dans la langue cible. Par exemple, la polysémie (un mot ayant plusieurs sens) ou les jeux de mots, omniprésents dans la littérature, sont souvent intraduisibles d’une manière qui conserverait à la fois leur sens et leur impact stylistique. Le traducteur doit donc parfois opter pour des traductions créatives en reformulant certaines expressions ou effectuer des compromis entre littérarité et littéralité, tout en restant fidèle à l’esprit de l’oeuvre.
Enjeux culturels
Les références culturelles, qu’il s’agisse de mythes, d’évènements historiques ou de particularités sociolinguistiques, peuvent poser problème. Certaines notions très enracinées dans une culture source peuvent ne pas avoir d’équivalents dans la culture cible, ou encore être interprétées différemment. Ainsi, le traducteur doit choisir entre expliquer ces références pour les rendre compréhensibles au lectorat cible, ou à défaut les conserver telles quelles, au risque de créer une distance ou une incompréhension.
Dimension stylistique
Le style de l’auteur est un autre élément difficile à rendre en traduction. Chaque auteur a une « voix » unique, un lexique, une musicalité, une poétique propre. Le traducteur doit par conséquent faire des choix délicats : doit-il respecter strictement la syntaxe et les tournures de phrases de l’original, ou doit-il les adapter pour préserver la fluidité du texte dans la langue cible ? Cela conduira inéluctablement à la perte d’éléments sonores et visuels constitutifs d’un texte littéraire, tels que les allitérations et les assonances, ou encore les rimes et autres figures de style visant à produire des effets sur le lecteur et spécifiques à une langue donnée.
Dilemmes éthiques
Inévitablement, les traducteurs littéraires sont confrontés à des dilemmes éthiques. Jusqu’à quel point peuvent-ils intervenir dans le texte, prendre des libertés pour l’adapter à un nouveau public, sans trahir l’auteur ? Cette question touche à la loyauté que le traducteur doit à l’oeuvre originale, mais aussi à la nécessité de rendre le texte accessible et plaisant pour les lecteurs de la langue cible.
En somme, cet article montre que la traduction littéraire est un exercice d’équilibre complexe, où le traducteur, tout en étant invisible, doit faire preuve de créativité et de sensibilité pour transmettre non seulement le contenu, mais aussi l’essence artistique d’une oeuvre littéraire.
Mots clés : littérarité, traducteur littéraire, défi
Bibliographie :
Argod-Dutard, F. (2011). Le français et les langues d’Europe. Dans Presses universitaires de Rennes eBooks. https://doi.org/10.4000/books.pur.33054
Lefort, R. (2020, 10 décembre). La question de la littérarité aujourd’hui. https://amu.hal.science/hal-03946799v1
Universalis, E. (s. d.). Définition de littérarité. Encyclopædia Universalis. https://www.universalis.fr/dictionnaire/littérarité/
Star Wars ou la guerre du doublage
Star Wars VI, le Retour du Jedi
Par Nina Liotard, Master TPS, promotion 2023-2025
Star Wars : tout le monde connaît ce pilier du cinéma, ne serait-ce que de nom. Si l’engouement autour du premier film semble évident de nos jours, en 1977 (date de sortie du premier opus), il relevait plutôt de la surprise voire du miracle, aux yeux des critiques et du réalisateur du film lui-même, George Lucas. En 1977, la science-fiction était un genre tout nouveau, considéré comme peu crédible (à l’exception de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick sorti en 1968). Cet aspect « sans précédent » du long-métrage se ressent dans l’adaptation française de l’époque. En effet, dans Star Wars ou La Guerre des étoiles, les noms propres et autres néologismes sont un élément majeur de l’immersion du spectateur au sein de cette galaxie lointaine, très lointaine.
La version française du film est on ne peut plus clivante : certains louent le charme teinté par les années 1970, d’autres estiment la VF trop libre, voire ratée. Qu’en est-il réellement ?
Des exemples d’adaptation
Un des exemples les plus étranges pour une oreille moderne est la traduction des noms propres : Darth Vader devient Dark Vador, Jabba the Hutt devient Jabba le Forestier (sans grande explication), Chewbacca devient Chictaba, Han Solo devient Yan Solo (son nom original étant trop proche du prénom « Anne »), etc. La VF se permet également beaucoup d’adaptations, au sens littéral, et diverge ainsi du ton de l’original. Certaines répliques semblent tout droit sorties de dialogues écrits par Michel Audiard, par exemple, lorsque Han traite Greedo de « pauvre cave » ou encore lorsque le contrebandier s’adresse à Luke : « T’énerve pas p’tit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer » (« Watch your mouth or you’re floating home »).
Une adaptation menée par un seul homme
Ces choix d’adaptations, pouvant sembler curieux à notre époque, sont l’œuvre d’une seule et unique personne : Éric Kahane. Ce dernier, traducteur et adaptateur de renom, a été imposé par la 20th Century Fox France. Il était seul aux commandes et on ressent une inspiration provenant de son domaine de prédilection, le théâtre. Pour les épisodes qui suivront, le studio nommera un autre directeur artistique. Les choix, plutôt osés, de traduction ont donc été revus et modifiés (excepté l’indéboulonnable « Dark Vador »).
Une adaptation qui fait parler d’elle
De nos jours, la VF de Star Wars suscite toujours des débats. Les aficionados de la VF défendront l’aspect unique de cette adaptation, lui donnant une identité propre empreinte de nostalgie. Au contraire, beaucoup trouvent cette adaptation vieillissante et trop détachée du matériau d’origine, ce qui nuit à l’expérience du spectateur.
Bonne ou mauvaise adaptation ?
Cette adaptation est, certes, datée mais il ne faut pas oublier le contexte. En 1977, la science-fiction était un ovni dans le paysage cinématographique populaire et Star Wars était une révolution. La VF est le témoin de cette période dans laquelle le Nouvel Hollywood (porté par des réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Steven Spielberg ou encore George Lucas) n’était pas encore solidement ancré. Or, de nos jours, la science-fiction n’est qu’un genre parmi les autres et ses codes nous sont très familiers, en témoigne la « postologie » Star Wars dont la VF a totalement perdu ses ajouts et clins d’œils culturels franco-français.
Cette conclusion n’a pas pour objectif de déterminer si l’adaptation de 1977 est bonne ou mauvaise mais bien de montrer que la saga Star Wars est un témoin majeur de l’évolution des choix de traduction dans le domaine audiovisuel. À votre tour de vous forger votre propre opinion sur la VF de la trilogie originale.
Mots-clefs :
Traduction audiovisuelle, adaptation, Star Wars
Pour aller plus loin :
ALTERMAN, Mathieu, « Il y a 40 ans, Star Wars sortait en France dans un grand n’importe quoi ». Le Point, 20 octobre 2017, URL : https://www.lepoint.fr/pop-culture/il-y-a-40-ans-star-wars-sortait-en-france-dans-un-grand-n-importe-quoi-20-10-2017-2166021_2920.php#11
DELCROIX, Olivier, « Star Wars, ou La Guerre des étoiles en français dans le texte », Le Figaro cinéma, 16 janvier 2017, URL : https://www.lefigaro.fr/cinema/2016/12/25/03002-20161225ARTFIG00010–star-wars-ou-la-guerre-des-etoiles-en-francais-dans-le-texte.php
GILLET, Louis, L’invisibilité à l’image : le cas de la traduction audiovisuelle, Mémoire de deuxième année de Master Études Culturelles, Monde Anglophone, Aix-Marseille Université, 2019
JACCOMARD, Hélène, « Star Wars : La Guerre des étoiles ? Une traduction qui n’en est pas une », Traduire, numéro 239, pp. 77-86, 2018, URL : http://journals.openedition.org/traduire/1580
LÉGER, François, « « Chico on met la gomme ! » : retour sur la VF culte de La Guerre des étoiles, sorti il y a 40 ans », Première, 02 janvier 2018, URL : https://www.premiere.fr/Cinema/Chico-on-met-la-gomme-retour-sur-la-VF-culte-de-La-Guerre-des-etoiles-sorti-il-y-a-40-ans
Cette IA qui aspire à remplacer les traducteurs
Image générée par une intelligence artificielle
Par Enora Corduan, Master TPS, promotion 2023-2025
« L’IA de traduction qui bluffe tout le monde », « L’IA capable de doubler une vidéo dans plusieurs langues simultanément », « L’IA qui rend quiconque polyglotte » … La presse n’a pas tari d’éloges au sujet de l’application HeyGen lors de la sortie de son outil de traduction instantanée de vidéos en 2023. Réaction immédiate : pour beaucoup, les traducteurs et interprètes auraient du souci à se faire face aux progrès de l’intelligence artificielle (IA).
HeyGen en quelques mots
Lancée en 2020 par l’ingénieur Joshua Xu, la plateforme Movio (ancien nom de HeyGen) avait initialement pour unique fonction la création d’avatars hyperréalistes capables de reproduire le discours de votre choix. C’est en 2023 que l’application lance sa fonctionnalité “Video Translate”, celle qui l’a rendue célèbre à travers le monde, a impressionné le grand public et a fait frissonner les traducteurs.
Les promesses d’un outil de doublage instantané
La promesse est simple : pouvoir parler n’importe quelle langue. Pour le fondateur, sa mission est de briser la barrière de la langue, notamment pour rendre le contenu vidéo en ligne plus accessible. Aujourd’hui, l’application peut traduire une vidéo en 40 langues différentes et en quelques secondes seulement. L’application s’est fait remarquer pour le réalisme de ses vidéos, rendu possible grâce à la synchronisation labiale, la reproduction des voix et des mimiques. Il est également important de mentionner sa facilité d’utilisation. Accessible au grand public, il vous suffit d’enregistrer une vidéo de quelques minutes grâce à l’application installée sur votre téléphone, de choisir la langue cible et de patienter quelques secondes avant de vous entendre parler dans une langue étrangère et avec un accent parfait.
Inquiétudes
L’application est rapidement devenue virale grâce à différentes vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, une vidéo du général de Gaulle donnant un discours en portugais ou, plus insolite encore, un journal télévisé présenté par Gilles Bouleau…en hindi. Cependant, ces prouesses techniques ont très rapidement suscité des inquiétudes. Notamment pour ce qui est de la disparition de certains emplois. En effet, les professionnels du doublage craignent de se voir remplacer par l’IA, cette dernière étant bien plus compétitive du point de vue de sa rapidité et de son coût. Ils ne sont toutefois pas les seuls affectés par cette technologie. Les créateurs de cet outil aimeraient, sur le long terme, pouvoir interpréter des débats télévisés en direct, retranscrire et traduire des discours instantanément ou encore sous-titrer des films intégralement ; menaçant presque l’intégralité des métiers de la traduction.
Enfin, la possibilité de pouvoir modifier des vidéos tout en conservant la voix d’une personne pose des questions quant aux risques de désinformation. Dans les mains de personnes mal intentionnées, cette technologie pourrait conduire à la propagation de deepfakes, ces vidéos truquées hyperréalistes permettant de faire dire ce que l’on souhaite à n’importe qui.
Limites
Bien que cette avancée technologique soit impressionnante et puisse susciter des débats quant à la pérennité de certaines professions, les traducteurs semblent avoir de beaux jours devant eux. En effet, l’une des plus grandes forces de l’homme reste sa capacité à saisir les subtilités et donc à comprendre les expressions, les jeux de mots, les références culturelles, le sarcasme…ce que l’IA n’est pas encore capable de faire. De plus, dans le cas de HeyGen, bien que la voix soit de bonne qualité, on peut ressentir des tonalités robotiques dans son discours ou encore un manque d’intonations caractéristiques sur certains mots ou expressions. Enfin, n’oublions pas que les vidéos qui ont été relayées dans les médias se comptent sur les doigts de la main ; seules les vidéos réussies ont été diffusées et non les échecs qui les ont précédés.
Mots clés : IA, HeyGen, doublage
Pour aller plus loin :
Cahon, S., & Chenouard, M. (2023, 27 septembre). L’IA de Traduction Vidéo, « Un outil de propagande parfait ». Courrier international. https://www.courrierinternational.com/video/video-l-ia-de-traduction-video-un-outil-de-propagande-parfait
Diallo, K. (2023, 11 octobre). IA : Cette appli vous fait parler dans une autre langue en vidéo. L’Éclaireur Fnac. https://leclaireur.fnac.com/article/349592-ia-cette-appli-vous-fait-parler-dans-une-autre-langue-en-video/
Mbida, A. (2023, 15 septembre). Heygen l’IA capable de doubler une vidéo dans plusieurs langues simultanément. Franceinfo https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/aujourd-hui-c-est-demain/heygen-l-ia-capable-de-doubler-une-video-dans-plusieurs-langues-simultanement_6032492.html
Pialat, L. (2023, 15 septembre). États-unis : HeyGen, l’IA capable de faire parler plusieurs langues à n’importe qui. Franceinfo. https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/bientot-chez-vous/etats-unis-heygen-l-ia-capable-de-faire-parler-plusieurs-langues-a-n-importe-qui_6036101.html
Williams, A. (2023, 1er octobre). IA : L’application HeyGen, qui rend Quiconque Polyglotte, soulève des inquiétudes. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2014240/doublage-cinema-intelligence-artificielle-traduction
L’importance de la localisation en marketing
Par Julie Loquais, Master TPS, promotion 2023-2025
Qu’est-ce que la localisation ?
Si vous n’êtes pas familier avec cet exercice, laissez-moi vous l’expliquer. Il s’agit, en traduction, de l’adaptation du texte source à la région géographique (un pays, une région, une ville). L’adaptation concerne l’ensemble du document source : le texte (références culturelles, heure, unités de mesure, jargon…) mais aussi tous les signes non-linguistiques (couleurs et images utilisées par exemple). Il faut donc avec une connaissance précise de la culture de la région cible.
La localisation en marketing
Lorsqu’une entreprise ou une marque se lance dans une opération de marketing, elle a pour but d’attirer des consommateurs et de leur donner envie d’investir dans le produit ou dans le service proposé. Sont alors utilisés divers outils de communication, comme la publicité.
La localisation est d’autant plus importante en marketing car pour qu’une publicité fonctionne, il faut qu’elle attire l’œil du public, qu’elle soit mémorable et accrocheuse. Une mauvaise traduction de cette publicité peut avoir l’effet inverse et offenser le public, affectant ainsi l’image de la marque ou de l’entreprise.
C’est pourquoi, de nombreuses sociétés font le choix d’utiliser l’anglais dans leurs communications publicitaires. Cela leur permet de toucher un public plus large sans craindre un échec de la localisation.
Les échecs de localisation dans la publicité
Il arrive parfois, souvent par manque de connaissances de l’argot dans la langue cible, que la localisation n’ait pas l’effet escompté. Vous trouverez ci-dessous quelques échecs de localisation en marketing.
Electrolux
Crédit photo : Electrolux
Electrolux est une marque d’électroménager suédoise qui a décidé d’adapter le slogan de sa nouvelle gamme d’aspirateurs « Rien n’aspire plus qu’un Electrolux » au marché américain. La société a ainsi fait le choix d’axer sa campagne publicitaire autour de la puissance de son produit. Toutefois, le slogan a été traduit en anglais par « Nothing sucks like an Electrolux ». Or, « suck » en anglais signifie principalement « craindre » ou « être nul ». La campagne de publicité américaine a sans doute eu moins de succès que prévu.
Ford
Crédit photo : Ford
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le fabricant automobile Ford a lancé une campagne publicitaire, dans les pays lusophones notamment, sur ce thème. La marque a utilisé pour ce faire le slogan « Put a Pinto under your tree », soit « mettez une Pinto sous votre sapin ». Or, au Brésil « pinto » est un terme familier désignant l’appareil génital masculin. Après s’être rendu compte de son erreur, l’entreprise a rapidement modifié son affiche. Mais aucun doute que ce slogan a marqué les esprits !
Quand la localisation fait le succès de la publicité
À l’inverse des exemples précédemment cités, certaines marques font preuve d’une grande ingéniosité dans l’exercice de localisation et de transcréation. C’est notamment le cas de deux grandes chaînes de restauration rapide qui adaptent leurs menus en fonction des pays où ils sont implantés.
En Inde par exemple, McDonald’s a supprimé de sa carte tous les burgers à base de bœuf et de porc car la vache est un animal sacré dans ce pays qui compte également une grande communauté musulmane. Ils ont donc été remplacés par des sandwichs végétariens ou à base de poulet.
Enfin, Burger King est connu pour ses publicités marquantes tournées autour d’expressions françaises ou de jeu de mots. Cet hiver par exemple, la chaîne a sorti des sandwichs à base de cantal, de fourme d’Ambert ou de fromage de chèvre. Nous avons donc pu voir apparaître dans les rues des affiches publicitaires reprenant des expressions ou des références culturelles françaises bien connues pour mettre en avant ces fromages.
Crédit photo : Burger King
Ces publicités font partie de notre quotidien alors ouvrez grand les yeux et vous serez peut-être le prochain à remarquer un de ses fameux échecs de localisation !
Pour aller plus loin :
Landecy, C. (2023). La localisation en marketing : une approche incontournable pour les marques globales. Hubspot. Consulté le 11/09/2024 sur https://blog.hubspot.fr/marketing/marketing-localisation
Pruvoost, L. (2024). Top 5 des erreurs de traduction commises par des marques. J’ai un pote dans la com. Consulté le 11/09/2024 sur https://jai-un-pote-dans-la.com/top-5-erreurs-traduction-marques/
Localisation. a4traduction. Consulté le 11/09/2024 https://a4traduction.com/glossaire-de-la-traduction/Localisation
Qu’est-ce que sont les intraduisibles en traduction ?
Par Zoé Herbreteau, Master TPS, promotion 2022-2024
En japonais, le mot « Komorebi » désigne la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres.
Les mots comme celui-ci qui n’ont pas d’équivalent dans d’autres langues existent pourtant dans chacune d’entre elles et nous en donnerons des exemples ci-après. Ces mots qui posent problème à tous les traducteurs lorsqu’ils les rencontrent car ils n’ont pas de traduction propre dans la langue cible sont appelés les intraduisibles. Les intraduisibles sont des mots très intéressants étant donné qu’ils reflètent la culture ou bien la réalité culturelle d’un pays. Ces mots permettent de nous faire remarquer que nous pensons à travers notre langue, et que les différentes langues produisent des mondes différents. Cependant, l’inverse est tout aussi vrai, les mondes différents produisent des langues différentes. Effectivement, ils nous montrent qu’à un moment donné des personnes ont eu besoin de trouver des mots, des expressions, des notions pour exprimer et communiquer un sentiment, un concept, une idée, une référence ou un moment bien précis qui est commun à de nombreuses personnes parlant la même langue. Alors qu’un autre peuple et une autre langue n’auront pas les mêmes besoins ainsi il n’y aura pas d’équivalent dans la langue cible.
Pour les traduire, il est donc nécessaire de passer par une périphrase ou bien une explication afin qu’ils soient compris par le lecteur. Ainsi, ces mots posent souvent problème aux traducteurs afin de trouver la meilleure adaptation sans trop alourdir le texte. C’est donc un jeu de patience et de balance.
Pour illustrer mes propos, je vais vous donner des exemples qui me semblent parlants dans quatre langues.
ESPAGNOL
● « Sobremesa » : le moment après le repas de détente qui est traditionnel en Espagne, où l’on continue de discuter avec ses amis ou sa famille.
● « Achuchar » : l’action de serrer une personne très fort dans ses bras affectueusement, parfois même jusqu’au point qu’elle ne puisse plus respirer.
ANGLAIS
● « Eyeservant » : une personne qui ne travaille que quand quelqu’un la surveille.
● « Elope » : l’acte de s’enfuir avec quelqu’un pour se marier en secret (dans le dialecte sicilien, un mot ayant la même définition existe : fuitina).
● « Empowerment » : le fait de donner plus de liberté ou de droits à un groupe de personnes.
FRANÇAIS
● « Dépaysement » : sentiment positif ressenti le plus souvent quand on se trouve à l’étranger ou entraîné par un changement de nos habitudes ou de notre environnement.
● « Pied-à-terre » : logement secondaire que l’on occupe occasionnellement, par exemple dans le cadre des vacances ou du travail.
● « Retrouvaille » : évènement joyeux de retrouver une ou des personnes (le plus souvent qui nous sont chères) après une longue période sans se voir.
Afin de mieux comprendre la complexité de l’exercice, je vais prendre l’exemple de « eyeservant » ci-dessus et essayer de trouver un équivalent en français. On pourrait traduire ce mot par fainéant, paresseux, flemmard. Cependant, cela ne recouvre pas exactement tous les détails de ce mot anglais. Ainsi, on va soit devoir expliquer le mot avec un étoffement ou bien choisir de perdre une partie de son sens et donc une partie du message.
Comme vous aurez pu le remarquer, le plus souvent ces mots sont tellement imprégnés dans notre quotidien qu’on n’envisage aucun équivalent dans une autre langue.
La Traduction des Mèmes : quand internet manie l’humour
Par Ilona Gisclard, Master TPS, promotion 2022-2024
Connaissez-vous les mèmes ? Ces images ou ces vidéos accompagnées de textes, qui affluent sur internet pour nous régaler de blagues sarcastiques ? Issu du terme anglais « meme », le mème a été inventé en 1976 par Richard Dawkins qui le définit comme une « unité d’information contenue dans un cerveau, échangeable au sein d’une société ». Cette idée repose sur le principe de la sélection naturelle, où le mème s’apparente au gène et se transmet ou disparaît, selon son évolution. Mais trêve de charabia scientifique.
Les mèmes forment un langage à part entière. Toutes les cultures peuvent les comprendre, et ils peuvent être adaptés dans toutes les langues car leur structure est simple. Un mème est un « objet graphique, communicationnel et social, très viral, qui fonctionne avec sa propre grammaire, son propre code ». Les mèmes sont une clef dans la communication internet et la propagation d’idées ou de tendances, mais pour les propager, encore faut-il réussir à les traduire… Entre références culturelles, humour, subtilités linguistiques, durée de vie et plateforme de diffusion, on peut facilement s’emmêler les pinceaux.
Comment traduire l’éphémère ?
À l’heure d’Internet, la communication passe souvent par le biais d’images ou de sons qui permettent cette instantanéité si addictive. Les mèmes n’échappent pas à cette règle. On estime qu’ils ont leur propre durée de vie, parfois courte. Ils sont donc sans cesse détournés, transformés et retraduits. Ils représentent un challenge de taille pour les traducteurs. Comment capter l’essence d’un mème et retranscrire l’idée, voire l’émotion qui l’accompagne, avant que le mouvement ne passe ? Les mèmes sont des tendances, et si on ne sait pas les saisir à temps, ils tombent dans l’oubli.
C’est le cas de termes rendus très populaires vers la fin des années 2010, comme « bomboclaat » ou « trollface » dont l’utilisation est aujourd’hui passée de mode. Les mèmes s’emparent de l’actualité et de la culture populaire afin de toucher tous les internautes. C’est leur structure simple qui permet leur transmission, mais celle-ci passe par le biais de la transcréation qui n’est pas toujours si évidente.
On notera que les exemples de cet article sont principalement en anglais. Je ne fais pas les règles, l’humour anglophone est imbattable.
Est-ce qu’on traduit, ou on transcréé ?
Le mème implique obligatoirement d’utiliser sa créativité pour transmettre une idée, le plus souvent de manière humoristique, sans prêter à l’interprétation. On parle même de « mémétique » tant il s’est imposé comme un langage à part entière. Lorsqu’il s’agit d’image, le sens est préservé grâce à ce support et à sa signification claire. Quand c’est un texte, il faut alors garder la dynamique originale du mème pour l’adapter à ses besoins et à la langue cible. Voici un exemple de mème populaire qui a très souvent été détourné :
On pourrait parler de traduction « cibliste », c’est-à-dire adaptée à son public cible, tant le message se transforme afin d’être compris par le public cible. Ce qui prime ici, ce sont les idées. La forme est un support au message.
Et les traducteurs dans tout ça ?
Évidemment, selon le matériau d’origine, la traduction, voir la transcréation, est plus ou moins facile. Il n’est pas toujours nécessaire d’être traducteur professionnel pour adapter un mème, il faut en revanche avoir une parfaite maîtrise de la culture populaire et de son public cible. L’humour et la pertinence sont préservés lorsque le traducteur parvient à garder l’efficacité du mème. Pour cela, il faut garder des messages courts et le plus souvent, c’est l’ironie qui prime !
Quels défis pour les traducteurs ?
La traduction des mèmes représente cependant un vrai défi, car il est non seulement question de créativité, mais aussi de rapidité. On parle souvent des mèmes comme d’un phénomène viral, où les idées se transmettent et contaminent les utilisateurs à la manière d’un virus. Ce caractère instantané du mème oblige les traducteurs à se maintenir à l’affût de l’actualité, afin de ne manquer aucune tendance, aucun néologisme, qui pourrait représenter un problème de traduction. Certains termes devenus des mèmes sont par essence intraduisibles, puisqu’ils sont issus de dialectes qui ont évolué avec le temps. Le terme d’origine perd alors tout son sens pour devenir une référence internet. Pour les linguistes, il faut alors faire la part entre l’étymologie et la manière dont les internautes s’emparent de la langue pour la « mémifier ».
Il s’agit non seulement d’un travail de langage, mais aussi de communication plus générale où le traducteur suit le courant, soit pour préserver le sens, soit pour s’adapter aux évolutions de celui-ci. Le traducteur doit déterminer avec précision les attentes du public cible et user de sa créativité pour garder des connotations drôles, en lien avec l’actualité.
Pour résumer
De phénomène de mode à outil de communication, le mème s’est imposé comme un langage internet. Utilisé dans le cadre privé, en marketing ou en politique, il sert à faire passer des messages avec humour. Pour permettre sa transmission et sa diffusion, le traducteur savoir adapter le sens en privilégiant la culture du public cible et l’humour, et en prenant en compte la rapidité des tendances. C’est un travail de créativité.
Le traducteur a un impact significatif sur la culture mondiale, car il contribue à la transmission de ces idées. Il permet à des tendances de s’instaurer durablement, de se répandre, et à tous les internautes de s’en emparer pour mieux les utiliser. Quand il s’agit de mème, le traducteur est plus qu’un linguiste.
Pour aller plus loin :
https://www.cairn.info/revue-travaux-de-linguistique-2016-2-page-27.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mème
https://technologie.toutcomment.com/article/qu-est-ce-qu-un-meme-definition-et-exemple-14861.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14781700.2022.2052950
Schjoldager, Anne. 2020. « The Usefulness of Equivalence within Translation Studies: Memes, Paradigms and a Functional Translation Analysis. » In Equivalence(s). Necessity and Challe…
Trados Studio, une aide à la traduction ?
Par Florine Héraud, M2 TPS promo 2022-2024
Dans un monde hyperconnecté, la traduction est une nécessité. La quantité de documents est donc toujours plus importante et les délais toujours plus courts. Heureusement pour nous, il existe de nombreux outils pour nous aider à tenir le rythme. Parmi eux, les outils de traduction assistée par ordinateur (en abrégé, outils de TAO). Ils sont une aide à la traduction grandement utilisée par beaucoup de traducteurs, même s’ils ne sont en rien nécessaires à la pratique de la traduction.
Ces outils peuvent prendre différentes formes (il peut s’agir de logiciels à télécharger ou de plateformes liées au Cloud), être plus ou moins accessibles (certains, comme OmegaT, sont gratuits, d’autres, tels que memoQ ou Trados Studio, sous licence). Il en existe énormément, tous différents et avec leurs propres points forts et leurs propres options. Dans cet article, nous nous pencherons sur Trados Studio, l’outil de TAO le plus connu et le plus utilisé sur le marché actuellement.
Pourquoi utiliser Trados Studio ?
Comme tous les outils de TAO, le but premier de Trados Studio est de nous faire gagner du temps et de nous aider à améliorer notre productivité. Pour cela, il permet une classification des projets, ainsi que la possibilité de créer ou d’ajouter des mémoires de traduction et des bases terminologiques. Si ces termes ne vous parlent pas, pas de panique, en voici une courte explication : une mémoire de traduction est un tableau créé par un outil de TAO (ici, Trados Studio) qui regroupe tous les segments sources et cibles de manière à les réutiliser lorsque vous traduisez un texte répétitif ou des textes similaires ; une base terminologique, c’est un glossaire qui aide à l’harmonisation globale du texte.
Point important de Trados Studio : il prend en charge tous les types de documents. Du format Word au format PDF, en passant par les PowerPoint, Trados Studio vous évite d’avoir à convertir vos fichiers à l’aide d’un autre logiciel et vous épargne les heures de mise en page qui en découlent. De plus, il garantit une sécurité optimale pour vos projets confidentiels.
Si Trados Studio se distingue réellement de ses concurrents, c’est parce qu’il est utilisé par la plupart des clients et des agences. Ainsi, il est important de savoir s’en servir même si vous ne possédez pas de licence, car votre donneur d’ouvrage peut vous en fournir une le temps du projet.
Et qu’en est-il des inconvénients ?
Le principal inconvénient de Trados Studio est son prix. Bien qu’il ne soit pas le plus cher sur le marché, il faut compter 324 € par an pour une licence et 755 € pour une souscription à vie, à laquelle il faudra ajouter au moins 300 € par mise à niveau.
Il faut également être conscient que Trados Studio est un logiciel professionnel, assez difficile à prendre en main et nécessitant certains prérequis avant d’accéder à la productivité recherchée. En effet, si les mémoires de traduction et bases terminologiques sont très utiles, il faut d’abord les créer. De plus, toutes les options proposées ne sont pas évidentes à utiliser et il faut s’attendre à un temps d’adaptation et d’expérimentation avant de maîtriser le logiciel. Sur ce point, vous trouverez des astuces et des formations directement sur leur site internet.
Par ailleurs, il est important de noter que comme beaucoup d’autres logiciels de TAO, Trados Studio n’est pas disponible sur Mac.
Conclusion
Pour conclure, Trados Studio possède de nombreux avantages qui vous aideront dans vos activités de traduction, à condition de prendre le temps d’apprendre à le maîtriser. Une fois pris en main, ce logiciel a tout ce qu’il faut pour vous accompagner dans les défis que vous rencontrerez. Trados Studio reste donc un investissement (de temps et d’argent) pertinent pour votre activité professionnelle.
Mots clés :
Traduction, TAO, outil de traduction assistée par ordinateur, Trados Studio, mémoire de traduction, base terminologique, productivité
Pour aller plus loin :
https://www.trados.com/fr/product/studio/
https://www.polilingua.fr/blog/post/outils_tao.htm
https://localazy.com/blog/top-10-cat-computer-assisted-translation-tools-to-try-as-translator
https://www.translatonline.com/top-5-logiciels-tao/
Retitrage des films : entre traduction et marketing
Par Charlotte Caherec, Master TPS, promotion 2022-2024
Si au Québec, les titres de films sont encadrés par la Loi et doivent être obligatoirement rédigés en français, il n’existe aucune obligation légale en France. Ce sont généralement les distributeurs qui décident et, en matière de titres de films, nous allons voir que la traduction ou « retitrage » n’est pas toujours la norme.
Pourquoi traduire les titres de films ?
Le choix du titre d’un film s’inscrit dans une stratégie marketing, au même titre que la promotion, la bande-annonce et l’affiche du film. Le titre est censé appâter le spectateur. Un titre qui n’est pas compris ou qui est mal compris peut compromettre le succès du film.
Quelles sont les contraintes de traduction ?
Tout d’abord, le titre doit être accrocheur. Il doit avoir un lien logique avec le film, être évocateur sans trop en dévoiler. On se souvient encore de la traduction de The Shawshank Redemption par Les évadés… Il doit être facilement compréhensible, lisible et prononçable, et assez court, tout en étant adapté au public cible. Plusieurs possibilités s’offrent alors au distributeur, les titres peuvent être conservés dans la langue d’origine, adaptés ou traduits.
Conservation du titre original
Le choix de ne pas traduire les titres de films ou de séries peut être le produit d’une stratégie commerciale, en particulier dans le cas des films américains. L’anglais vend mieux car il est vu comme plus moderne et parle plus aux jeunes.
Les distributeurs ont également tendance à conserver le titre original lorsqu’il s’agit d’un film important, très attendu ou signé par un grand réalisateur. C’est le cas, par exemple, de la majorité des films Marvel : Black Widow, Avengers, Black Panther : Wakanda Forever, Captain America : Civil War, Spider-Man : Homecoming…
Le réalisateur du film peut également exercer son droit d’auteur et exiger que le film conserve son titre original à l’étranger.
Adaptation du titre anglais en anglais
Il y a quelques années, la tendance était à l’adaptation des titres anglais en anglais. Cette démarche visait à remplacer les termes compliqués à comprendre par du « globish », un anglais compréhensible par des non-anglophones. Cette tendance avait engendré une aseptisation des titres, qui finissaient pour la plupart d’entre eux, avec des mots à connotation sexuelle utilisés volontairement pour cibler un public adolescent :
Step Up → Sexy dance
Eurotrip → Sex trip
No Strings Attached → Sex friends
Wild things → Sexcrimes
Traduction du titre en anglais
En France, il arrive également que certains titres de films étrangers non-anglophones soient traduits en anglais, c’est le cas d’un grand nombre de films et séries asiatiques :
시 → Poetry
歩いても 歩いても → Still Walking
헤어질 결심 → Decision to leave
오징어게임 → Squid Game
Traduction du titre en français
En fonction du public cible, il est évident que certains titres se doivent d’être traduits en français, les titres des films d’animation par exemple :
Frozen → La Reine des neiges
Sing → Tous en scène
Finding Nemo → Le Monde de Nemo
Tangled → Raiponce
De la même manière, pour les œuvres cinématographiques adaptées d’œuvres littéraires, le titre choisi coïncide souvent avec celui de la traduction de l’œuvre littéraire :
The Handmaid’s Tale → La Servante écarlate
The Help → La couleur des sentiments
Never Let Me Go → Auprès de moi toujours
The Fault in Our Stars → Nos étoiles contraires
Retraduction du retitrage
Vous avez peut-être déjà remarqué que certains titres de films sont modifiés après leur sortie. De fait, la retraduction existe aussi dans le domaine du retitrage. En France, la saga Star Wars avait dans un premier temps été traduite par La guerre des étoiles pour au final récupérer son titre original.
En matière de titres, le géant du streaming Netflix affirme réaliser en permanence des études pour savoir quel titre fonctionne dans quel pays. La plateforme s’adapte alors en fonction de l’augmentation ou de la baisse du taux de visionnage. Elle a d’ailleurs remarqué que traduire un titre peut faire augmenter le nombre de vues jusqu’à 25 % mais peut également le faire baisser.
Pour résumer
Au-delà de l’acte de traduction en lui-même, le retitrage soulève plusieurs problématiques. Si les films américains dominent le box-office, les titres en anglais également. Le monde du cinéma n’échappe pas à l’anglicisation de la langue française. Désormais, même certains titres de films non-anglophones sont traduits, en France, en anglais. Pourtant, si l’on en croit Netflix, la conservation des titres originaux ne serait pas toujours à l’avantage du distributeur. Au Québec, la question ne se pose pas et même si certaines traductions de titres de films peuvent nous faire sourire, au-moins eux, ils ont essayé !
Mots clés : retitrage, titres, cinéma, transcréation, adaptation
Pour aller plus loin :
https://www.betranslated.fr/bt/traduction-titres-films/
https://a4traduction.com/glossaire-de-la-traduction/Globish
https://cinescover.wordpress.com/2020/09/08/debat-faut-il-traduire-les-titres-originaux-des-films/
Connaissez-vous vraiment la traduction littérale?
Par Théo Dethoor, Master TPS, promotion 2022-2024
Mots-clés = traduction littérale, traduction professionnelle, documents techniques
L’article résumé ci-dessous est ici : Quels sont les risques d’une traduction littérale ? – Traduc Blog
La traduction littérale revient à traduire mot à mot un contenu sans prendre en compte ni le contexte ni la manière avec laquelle les phrases sont structurées dans les textes source et cible. Les personnes n’étant pas expertes en traduction y ont souvent recours. Dans la plupart des cas de phrase isolée, celle-ci peut s’avérer pertinente ou dans des contextes non professionnels, si tenté que l’interlocuteur soit prêt à fournir les efforts de compréhension nécessaires. Elle est cependant, sinon à proscrire totalement, à utiliser avec minutie dans le cadre d’un contexte professionnel.
En effet, dans des situations de traductions professionnelles, la traduction littérale comporte des nombreux risques. Elle peut rendre le texte cible maladroit dans sa syntaxe et même partiellement voire totalement incompréhensible. Elle est également susceptible de créer des quiproquos ou des contre-sens dans le texte d’arrivée. Il arrive que certaines phrases se retrouvent dépourvues de sens voire hors-sujet. Enfin, notons que son utilisation peut dénaturer le style que l’auteur avait souhaité mettre en avant dans le texte source.
La traduction littérale est un processus auquel les traducteurs automatiques ont souvent recours. Cependant, elle est souvent décriée pour sans manque de précision et de fiabilité.
Les erreurs ou écueils que la traduction littérale peut provoquer sont divers. Dans cet article, nous allons en développer certains afin de comprendre comment les éviter.
Les erreurs de structure
Lorsque l’on traduit un texte, il y a un certain nombre de paramètres qu’il faut avoir en tête. Les structures respectives des langues source et cible en font partie. Il faut en avoir conscience pour éviter de tomber dans l’écueil de toujours adopter strictement la structure de la langue du texte de départ pour le texte d’arrivée.
En effet, dans de nombreux cas, la structure grammaticale d’une langue va nous imposer des choix de traduction. En allemand par exemple, le verbe dans les propositions principales est toujours placé en deuxième position. Si l’on applique cette méthode en français le sens s’en verra parfois altéré. En japonais, la structure « classique » d’une phrase est la suivante : sujet, objet, verbe. Or, dans la plupart des langues européennes, les phrases se construisent ainsi : sujet, verbe, objet. Une traduction littérale poserait donc des problèmes grammaticaux.
Les erreurs liées aux associations d’idées
Les erreurs liées aux associations d’idées sont fréquentes dans la traduction littérale de textes venant de langues comme le japonais ou le chinois. Il faut avoir conscience que dans ces langues, il est courant d’associer plusieurs caractères qui ont individuellement un sens pour former un nouveau « mot » avec un autre sens. Les dissocier à cause d’une traduction littérale serait donc une erreur.
Les erreurs liées aux expressions figées
Les expressions figées supposent de comprendre le sens de la phrase dans son ensemble car bien souvent elles n’ont pas le sens propre et littéral qu’elle devraient avoir.
N’y a-t-il que des désavantages dans la traduction littérale ?
Malgré les apparences, la traduction littérale peut tout de même être intéressante. En effet, si celle-ci sert de premier jet, elle peut même être pertinente dans certaines traductions professionnelles comme celle de documents techniques, à condition de bien s’en servir. Cependant, elle ne peut en aucun cas suffire à elle seule dans ce genre de travaux.
Bibliographie pour aller plus loin :
L’ordre des mots dans une phrase : 9. Ordre des mots et focalisation (jyu.fi)
La traduction littérale en japonais : Comment éviter la traduction littérale en japonais (grosse erreur de débutant…) – YouTube
La traduction des expressions idiomatiques en anglais : Traduction des expressions idiomatiques français – anglais (sotratech.com)
L’histoire de la traduction : Histoire de la traduction | Société française des traducteurs : syndicat professionnel (SFT)
La traduction des expressions figées en littérature : Traduttore traditore : de la possibilité de traduire les expressions figées en littérature – Textes et contextes (u-bourgogne.fr)
La retraduction littéraire : trouver l’équilibre entre authenticité et modernité
Par Lisa Suhard, Master TPS, promotion 2022-2024
Vous aviez certainement remarqué que le célèbre roman d’Agatha Christie se nomme désormais « Ils étaient dix » et que toutes les occurences du mot « nègre » avaient été remplacées par « soldat ». Ce changement illustre un phénomène courant que l’on appelle la retraduction. Ce procédé s’applique principalement aux textes littéraires, et notamment aux classiques de la littérature. Dans cet article, nous explorerons les enjeux de la retraduction et son rôle dans la préservation des œuvres littéraires.
La retraduction : qu’est-ce que c’est ?
La retraduction consiste à produire une nouvelle traduction d’une œuvre qui a déjà été traduite dans une langue donnée, créant ainsi plusieurs versions cibles d’un même texte original. Elle ne se limite pas à une simple réédition de la traduction existante, mais vise à apporter un regard nouveau sur l’œuvre originale. Plusieurs facteurs peuvent motiver une retraduction, notamment les progrès linguistiques, les évolutions culturelles et les perspectives changeantes sur les textes classiques.
Pourquoi retraduire ?
La nécessité de retraduire certains textes découle de l’ambition de redécouvrir une œuvre sous un angle différent et de l’adapter aux sensibilités contemporaines, afin d’éviter que les traductions ne vieillissent avec le temps. La retraduction permet de mettre à jour un texte pour que celui-ci reflète au mieux la société actuelle.
La retraduction permet ainsi de maintenir la vitalité des œuvres littéraires, afin d’éviter qu’un texte qui était autrefois révolutionnaire devienne daté pour un lecteur contemporain. La retraduction offre une occasion de rétablir la pertinence de l’œuvre, en la rendant accessible pour une nouvelle génération.
Quels sont les enjeux de la retraduction ?
La retraduction soulève des questions essentielles concernant la transmission littéraire à travers les époques, les langues et les cultures. Elle offre aux retraducteurs l’opportunité d’explorer des éléments qui ont échappé à la traduction précédente, de révéler de nouvelles couches de signification et de rendre justice aux subtilités du texte. En effet, il est commun de penser que l’on traduit de mieux en mieux, et par conséquent, chaque traduction pourrait bénéficier d’améliorations. Alors, les retraductions viseraient à rendre la traduction toujours plus précise.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de retraduire une œuvre, l’enjeu principal est de préserver son intégrité. Comment rester fidèle au texte d’origine tout en le rendant accessible pour les lecteurs contemporains ? Cette réinterprétation demande un équilibre subtil.
Tandis que la retraduction peut permettre à une œuvre de traverser les époques, elle peut être controversée et susciter débat. Certains estiment que les œuvres littéraires devraient être préservées dans leur forme initiale. En effet, lors de la lecture d’une œuvre, il serait essentiel de prendre en considération le contexte culturel et temporel dans lequel elle a été initialement écrite. Modifier ou « corriger » une œuvre peut être perçu comme une tentative d’effacer ou d’occulter une partie de son héritage historique ou culturel.
En outre, chaque retraduction peut ajouter de nouvelles interprétations, introduire des erreurs ou dévier de l’intention de l’auteur. Le risque est que l’œuvre soit progressivement transformée en un texte différent de l’original. Chaque retraduction est un acte de réinterprétation, et chaque retraducteur apporte sa propre vision et son propre style, en prenant le risque de s’éloigner de l’intention de l’auteur.
Pour résumer
La retraduction est une démarche complexe qui permet de préserver et de faire évoluer des œuvres littéraires au fil du temps. Elle offre de nouvelles perspectives sur des textes et permet aux lecteurs de les découvrir sous un nouveau jour. L’acte de retraduction permet alors de donner un caractère éternel à des œuvres qui pourraient autrement devenir archaïques. Toutefois, il n’y a pas de réponse définitive quant à son bien-fondé. Dans certains cas, la retraduction peut être considérée comme un procédé qui dénature une œuvre et lui fait perdre son authenticité.
Mots clés : Retraduction, Réinterprétation, Littérature classique, Traduction littéraire
Pour aller plus loin :
Marie Vrinat-Nikolov, « Retraduire : pourquoi ? », En attendant Nadeau, 2017.
Antoine Berman, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, 4 | 1990, 1-7.
Amélie Emery, « Du besoin de correspondre aux normes de son temps : étude de cas sur la retraduction du roman d’Agatha Christie « Ils étaient dix » », Université de Genève, 2021.
Les enjeux de la féminisation de la langue en traduction
Par Alysone Hersant, Master TPS, promotion 2022-2024
Nous savons que la langue française tend à favoriser l’emploi du masculin pour désigner un groupe de personnes, ce qui peut conduire à des stéréotypes de genre et à une invisibilité des femmes. L’utilisation du masculin pour désigner ces deux sexes est certes considérée comme la norme, mais elle peut ne pas être adaptée à certains projets de traduction.
L’importance de la féminisation de la langue dans la traduction dépend, en grande partie, des préférences du client ou de la cliente et du contexte. Certain·e·s client·e·s, particuliers ou professionnel·les, peuvent exiger une traduction inclusive pour refléter leur engagement envers l’égalité des genres, tandis que d’autres peuvent préférer une traduction plus traditionnelle. Il est alors essentiel pour un traducteur ou pour une traductrice de comprendre les enjeux du document à traduire ainsi que les attentes de son client ou de sa cliente afin de s’adapter en conséquence. La clé est donc la communication ouverte avec le ou la cliente pour répondre à ses besoins spécifiques en matière d’inclusivité linguistique.
Dans la traduction, la féminisation de la langue pose plusieurs enjeux :
- Le respect de la diversité : l’écriture inclusive vise à inclure toutes les identités de genre et à éviter les biais linguistiques. En traduction, une attention toute particulière à ces éléments reste essentielle au respect de la diversité et de la sensibilité culturelle.
- La cohérence avec la source : il peut être complexe de maintenir la cohérence de l’écriture inclusive tout en préservant le sens et le style du texte source. Un équilibre doit alors être trouvé entre cette féminisation de la langue et la fidélité au texte original.
- L’adaptation linguistique : dans certaines langues, l’écriture inclusive peut nécessiter des adaptations créatives pour éviter lourdeurs ou incohérences. Les traducteurs et traductrices doivent alors s’efforcer de trouver des solutions linguistiques appropriées. Heureusement, certaines règles de féminisation ont été mises en place dans certaines langues.
- Le public cible : les préférences en matière d’écriture inclusive peuvent varier selon les régions et les publics. Traducteurs et traductrices doivent alors prendre en compte ces facteurs pour produire une traduction pertinente pour le lectorat.
- L’évolution de la langue : l’écriture inclusive est en constante évolution. Il est donc important de rester informé·e au sujet des normes linguistiques émergentes en matière de féminisation de la langue.
En résumé, il paraît donc judicieux d’admettre que les enjeux de l’écriture inclusive dans la traduction sont essentiellement liés à la nécessité de concilier la féminisation de la langue avec la fidélité au texte source. Pour ce faire, il demeure primordial de tenir compte des spécificités linguistiques et culturelles de la langue cible, des préférences du client ou de la cliente et du public cible.
Réflexion et adaptabilité sont donc les mots d’ordre en traduction !
Pour aller plus loin :
- Écriture inclusive – Lignes directrices et ressources
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/cles-de-la-redaction/ecriture-inclusive-lignes-directrices-ressources
- FRACCHIOLLA Béatrice, “Anthropologie de la communication : la question du féminin en français”, Corela, [En ligne], 6-2, 2008, mis en ligne le 15 décembre 2008
- Femme, j’écris ton nom… Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions
https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/994001174.pdf
- L’écriture inclusive, un débat très politique
https://www.radiofrance.fr/franceculture/l-ecriture-inclusive-un-debat-tres-politique-9192371
L’art de traduire l’humour : une histoire de culture
Julie Angot, Master TPS, promotion 2021-2023
Il existe un lien étroit entre traduction et culture. Pour comprendre le langage humoristique de chaque groupe ethnique, il faut d’abord en connaître la culture.
Le rire est universel. Mais l’humour, culturel par essence, passe difficilement d’une langue à une autre. Pour restituer l’esprit de l’original, le traducteur doit faire preuve de beaucoup de créativité et d’inventivité.
En fonction de l’âge et de la personnalité de chacun, le sens de l’humour est variable. Cependant, la langue et la culture sont évidemment des facteurs tout aussi déterminants. L’humour est intrinsèquement lié à la culture dans laquelle il a été créé, mais aussi à la langue elle-même, par les jeux de mots, les calembours ou encore les références culturelles (pour ne citer que quelques types d’humour car la liste est longue). La traduction littérale d’une blague tombe souvent à l’eau ou est incompréhensible. Pour conserver l’esprit d’une blague, le traducteur est souvent contraint d’adapter radicalement cette blague, en créant quelque chose de nouveau, tout en conservant l’émotion et l’intention du texte original. C’est un procédé souvent utilisé pour traduire l’humour.
Pour les jeux de mots, et d’un point de vue général sur la traduction de l’humour, toute la difficulté réside dans le sens et l’ambiguïté des mots. Ce qui ne facilite pas les choses, c’est que la façon dont ces mots se prononcent et s’écrivent varie d’une langue à une autre. De plus, expliquer une blague n’est souvent pas une solution efficace non plus. Si le traducteur choisit d’expliquer la blague dans une autre langue, l’aspect humoristique risque fortement d’être perdu.
Mais que faire quand la blague est mauvaise ? Voilà encore un enjeu de taille. Le traducteur doit-il imaginer une autre mauvaise blague ou envisager quelque chose de plus drôle ? Tout dépendra de l’intention de l’auteur et du public cible, que le traducteur devra respecter à tout prix. La mauvaise blague n’a peut-être pas été écrite au hasard, il devient donc crucial de conduire cette intention dans une autre langue. Si au contraire, l’intention de l’auteur est de faire rire, le traducteur doit tout mettre en œuvre pour que la traduction ait « le même poids ».
Cet article permet de constater ou de se rappeler que chaque culture possède son propre sens de l’humour en fonction de son histoire, de ses traditions, de ses valeurs ou encore de ses croyances. Bien souvent, il n’y a que les personnes issues d’une même culture qui pourront comprendre une blague ou la trouver drôle. Trouver les mots justes pour préserver l’humour dans une langue cible est un véritable casse-tête pour le traducteur. Au-delà des mots, la traduction de l’humour, c’est tout un art. –
Mots-clés : humour, traduction, culture.
Pour aller plus loin :
https://journals.openedition.org/traduire/243#tocto1n5
https://www.fabula.org/actualites/79382/journee-d-etude-traduire-l-humour.html
https://books.openedition.org/pupvd/3194?lang=de
https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2010-v55-n1-meta3696/039603ar/
Le surtitrage à l’opéra
Par Marie Houry, master TPS, promotion 2021-2023
Avez-vous déjà entendu parler du surtitrage à l’opéra ? Cette pratique peu connue a su, au fil des quatre dernières décennies, se faire une place dans le milieu de l’art lyrique. Il consiste à retranscrire une traduction concise de ce qui est dit (ou chanté) sur scène. Dans les mondes de l’opéra et du théâtre, le texte de surtitrage sera, comme son nom l’indique, projeté au-dessus de la scène ou sur ses côtés.
- Qui est donc le surtitreur ?
Ce dernier est un traducteur dont la tâche est d’offrir au public des surtitres immédiatement compréhensibles, qui doivent être au plus près du livret original. Nous savons que l’exercice de traduction engage des contraintes imposées au traducteur. Cependant, dans le cas du surtitrage, celles-ci sont particulières. Il s’agit ici d’une traduction d’un texte oral vers un texte écrit, qui est donc régit par des contraintes d’espace et de temps. En effet, une phrase traduite doit pouvoir tenir sur l’écran et l’enchaînement de celles-ci doit s’aligner sur le débit de parole des comédiens mais aussi prendre en compte le temps dont le spectateur a besoin pour lire le surtitre. Le surtitreur doit faire preuve de concision dans l’exercice de traduction. Afin d’obtenir cette concision, le surtitreur doit faire des choix euristiques ; il va décider des informations qui sont indispensables ou non à la compréhension du discours et donc de la scène. Par exemple, les onomatopées et connecteurs logiques vont être supprimés, les prénoms des personnes déjà mentionnées ne vont pas être répétés, les phrases directes vont être privilégiées, les adverbes en -ment vont être évités car jugés trop longs… En soi, tout ce qui est superfétatoire va être omis.
Les compétences du traducteur surtitreur sont multiples. Il doit avant tout maîtriser les principales langues utilisées à l’opéra, à savoir l’allemand, l’anglais et l’italien. Il lui faut, de plus, étroitement travailler avec le metteur en scène et le chef d’orchestre, rendant sa présence aux répétitions essentielle.
Le surtitreur est également technicien. Comme nous le savons tous ici, il existe de nombreux outils informatiques dont le but est d’aider à la traduction. Néanmoins, rares sont ceux uniquement destinés au surtitrage. Le logiciel Torticoli (créé par l’informaticien Pierre-Yves Diez) est, pour le moment, le plus utilisé. Malheureusement, bon nombre de surtitreurs n’ont pour autre choix que d’utiliser le logiciel Power Point ; peu onéreux et facile d’utilisation, il permet d’entrer les surtitres dans les diapositives et de les diffuser grâce à un vidéoprojecteur. Le surtitreur est donc également « technicien » car il doit savoir faire les branchements nécessaires pour pouvoir projeter sa traduction et prendre en compte les éléments présents sur scène (comédiens et décors) ainsi que les lumières lorsqu’il est dans le cas de surtitrages intra-scéniques. Dans ce cas précis, la traduction est directement affichée en direction de la scène. Voilà pourquoi le surtitreur doit assister aux répétitions ; il doit pouvoir visualiser la scène, savoir où les jeux de lumière seront placés, ainsi que les décors et les mouvements des comédiens. Les surtitrages les plus utilisés restent les surtitrages extra-scéniques, que l’on retrouve au-dessus de la scène ou sur ses côtés. Ils représentent en effet moins de contraintes techniques pour le traducteur.
Ce dernier doit également être très attentif quant à la synchronisation entre l’affichage des surtitres et l’instant même où les chanteurs récitent leurs lignes. Il serait en effet désagréable pour le spectateur qu’il y ait un décalage entre ces derniers et que le public, par exemple, ait l’information en avance ou inversement.
- Avancée ou contrainte ?
Les avis sur le surtitrage divergent ; pour beaucoup, c’est une avancée qui facilite l’accès au monde de l’opéra. Cependant, pour ses détracteurs, il n’est autre que parasite ; il empêcherait le public de se concentrer sur la production en attirant son attention sur le dessus ou les côtés de la scène, mais pas sur ce qu’il s’y passe. De plus, selon eux, le surtitreur n’étant malheureusement « qu’un » humain, n’aurait pas la capacité de diffuser les surtitres au juste moment mais avec soit un instant de retard, soit un instant d’avance, provoquant ainsi les réactions du public en différé. Ils considèrent donc les livrets rédigés en amont, généralement traduits, plus intéressants que les surtitres car ils « garderaient le côté littéraire et musical » de l’œuvre, tandis que leurs cousins numériques, de par leur concision, rendraient le texte insipide et lui feraient perdre tout lyrisme.
Conclusion :
Le surtitrage est une branche de la traduction peu connue. En effet, lorsque quelqu’un explique être traducteur, la question la plus fréquente liée à ceci reste : « Vous traduisez donc des livres ? ». Ce monde est si large que beaucoup ignorent que ce domaine n’englobe pas seulement la littérature.
Le surtitreur traduit donc des opéras ou des pièces de théâtre. Comparé au traducteur littéraire, il doit cependant faire face à des contraintes que son homologue susnommé n’a pas : il doit en effet faire avec des contraintes temporelles et spatiales, doit faire preuve de concision (on parle alors de traduction condensatrice), utiliser des implicitations, travailler main dans la main avec les metteurs en scène et équipes techniques… Il possède donc des compétences multiples.
Pour aller plus loin :
https://www.authot.com/fr/2021/06/03/le-surtitrage-a-lopera/
https://journals.openedition.org/traduire/2202
https://mastertsmlille.wordpress.com/2020/09/27/traduire-pour-le-theatre-le-surtitrage/
http://sflgc.org/acte/aude-ameille-traduire-pour-ne-pas-traduire-les-surtitres-a-lopera/
Qu’est-ce que la localisation dans le secteur vidéoludique ?
Laurie Barbassat, Master TPS Promo 2021-2023
Tout d’abord, quelle est la différence entre traduction et localisation ?
La traduction consiste à transformer un texte écrit dans une langue en un texte équivalent dans une autre langue. La localisation, quant à elle, est une étape qui suit la traduction et qui consiste à adapter un produit ou un service à un marché spécifique. Cela peut inclure la traduction du contenu, mais cela va au-delà et inclut également la mise en forme du contenu pour qu’il convienne à la culture, aux pratiques commerciales et aux préférences du marché cible. La localisation en jeu vidéo est importante car elle permet de s’assurer que le jeu sera bien reçu par les joueurs du marché cible et qu’il aura du succès sur ce marché.
Quelles sont les difficultés à localiser un jeu vidéo ?
On compte 6 difficultés principales liées à la localisation en jeu vidéo :
- La traduction du contenu peut être complexe, car elle doit être fidèle à l’esprit du jeu tout en étant naturelle et fluide dans la langue cible. Cela peut être particulièrement difficile lorsque le contenu comprend des jeux de mots ou des références culturelles qui ne se traduisent pas facilement.
- La localisation peut nécessiter des changements au niveau du contenu du jeu pour s’adapter à la culture et aux préférences du marché cible. Par exemple, certains éléments du jeu pourraient être considérés comme offensants ou inappropriés dans certains pays et devront être modifiés en conséquence. Ce sera donc au localisateur de prendre en compte ces contraintes et de jouer autour, tout en dialoguant avec l’équipe du jeu vidéo et, si nécessaire, en censurant certaines données.
- C’est une technique coûteuse et qui peut prendre du temps, surtout si le jeu doit être traduit dans de nombreuses langues et adapté à de nombreux marchés cibles différents.
- La localisation peut être compliquée par la taille et la complexité du jeu, ainsi que par le fait qu’il peut il y avoir de nombreux intervenants impliqués dans le processus de localisation, tels que les traducteurs, les réviseurs, les testeurs et les développeurs de jeux.
- La traduction doit être adaptée à la longueur du texte dans la langue cible. Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier la mise en page du jeu pour s’adapter à la longueur du texte traduit, afin que le jeu reste esthétiquement agréable et facile à lire pour les joueurs, mais souvent les traducteurs n’ont pas accès aux information contextuelles ni au jeu lui-même et auront des fichiers de type tableur ou des captures d’écrans. Certains développeurs vont mettre des notes pour certains segments de texte pour aider à la localisation, notamment lorsqu’il y a des informations « cachées » dans les textes (comme par exemple des informations importantes glissées dans la narration du jeu).
- Des difficultés liées à la gestion des versions et à la maintenance du jeu peuvent survenir une fois qu’il a été localisé, car il peut il y avoir plusieurs versions du jeu en circulation dans différentes langues et pour différents marchés.
Pour conclure, il ne faut pas oublier que la localisation est encore un procédé récent, étant donné que la mondialisation des médias vidéoludiques est encore jeune. La traduction dans ce domaine est passée d’une simple boîte de jeu et de ses instructions à une localisation quasi-totale avec prise en compte des textes écrits, des sous-titrages et des fois même du doublage. La localisation va bien au-delà d’une rigueur linguistique, le traducteur-localisateur doit faire preuve d’adaptabilité pour ajuster sa traduction et il doit garder en tête l’histoire du jeu pour que le joueur soit pleinement immergé dans l’imaginaire du jeu auquel il joue.
Pour aller plus loin :
https://jesuisungameur.com/2022/01/27/localisation-traduction-jeux-video-histoire-evolution/
https://www.youtube.com/watch?v=lLMw6gxrtZc
https://altraductions.com/blog/differences-entre-la-traduction-de-jeux-video-et-la-traduction-standard
https://mastertsmlille.wordpress.com/2017/09/10/les-grands-commandements-de-la-localisation-de-jeu-video/
https://mastertsmlille.wordpress.com/2018/07/01/la-localisation-de-jeux-video/
Dalin, Morgan. « Les spécificités de la localisation de jeux vidéo: aspects techniques et traductologiques. » ことばの世界: 愛知県立大学通訳翻訳研究所年報 9 (2017): 35-47.
L’intelligence artificielle au service de la traduction
Un atout pour les traducteurs ?
Par Laura Stoeckel, Master TPS promotion 2021-2023
Aujourd’hui, une multitude de langues sont parlées dans le monde et presque toutes les cultures interagissent entre elles. Cela fait de la traduction un moyen de communication qui devient de plus en plus essentiel et de ce fait, les traducteurs sont primordiaux. Cependant, ces dernières années, nous avons assisté à l’évolution de la traduction automatique. Les logiciels utilisés sont de plus en plus performants, et donc leur utilisation est fortement en hausse. Mais alors les traducteurs doivent-ils voir cette émergence comme une menace ? La traduction automatique peut-elle remplacer la traduction humaine ?
Tout d’abord, un peu d’histoire…
La traduction automatique remonte aux années 1950. Nous sommes dans un contexte de guerre froide, les tensions géopolitiques sont présentes, c’est alors que le gouvernement des États-Unis souhaite créer une machine pour permettre d’espionner les Russes. Pour cette raison, le mathématicien Warren Weaver crée un moteur de traduction automatique qui se base sur le principe de « Language invariant », c’est-à-dire une traduction mot à mot. Donc à ses débuts, la traduction automatique était vraiment littérale. Pendant les décennies suivantes, des approches à base de règles ont été mises au point, et cela a conduit à des moteurs de traduction automatique plus compétents.
Les avantages apportés par la traduction automatique
Bien évidemment, son principal avantage est la rapidité. Les moteurs peuvent traduire des millions de mots en quelques secondes. De ce fait, ils proposent des traductions rentables, puisque le coût et le temps passé est moindre. De plus, la traduction automatique dispose d’un grand choix de langues, elle peut proposer des traductions pour plus de 100 langues. Tandis qu’à côté, la majorité des traducteurs peuvent traduire deux voire trois langues.
Les inconvénients de cette intelligence artificielle
Nous pouvons tout de même évoquer certaines limites de la traduction automatique. Certes, le gain de temps est indéniable, mais lorsque le moteur traduit, il n’a pas le contexte de la phrase, donc il peut fortement se tromper et ainsi, on peut arriver à des contresens. Même si cette intelligence artificielle ne fait que s’améliorer, elle ne pourra pas remplacer le traducteur. En effet, ce dernier a cette capacité à décrypter le sens d’un texte, à relever les sous-entendus, les jeux de mots…
D’autre part, le plus souvent, la traduction automatique rend un texte plus ou moins littéral et passe à côté de toutes les expressions idiomatiques ou les mots étrangers. Et donc ces intelligences artificielles sont vraiment en difficulté dans la retranscription de ces tournures de phrases. Enfin, ces moteurs deviennent beaucoup moins efficaces lorsque le texte source a un message plus complexe et plus long. Toute traduction automatique peut parfois nous donner de bons éléments, mais peut aussi traduire à côté de la plaque.
Ainsi, je pense qu’il ne faut pas voir la traduction automatique comme une menace pour la profession, mais plutôt pourquoi ne pas utiliser cet outil et faire valoir notre compétence de post-édition sur le marché ? De plus, la traduction automatique ne peut pas forcément remplacer la traduction humaine. Certes, ces moteurs peuvent être vus comme une menace du fait des avantages évoqués plus haut, mais sa qualité sera toujours inférieure à celle de l’humain et donc, afin de garantir une bonne traduction, l’intervention humaine demeure indispensable.
Et vous, utilisez-vous les moteurs de traduction automatique ? Ou préférez-vous vous tourner vers un traducteur expérimenté ?
Pour aller plus loin :
- Beacco, JC. (2022). Traduction automatique et usages sociaux des langues. Bookelis.
- Loffler-Laurian, AM. (1998). La traduction automatique. Presses Universitaires Du Septen-Trion
- Qu’est-ce que la traduction automatique ? | SYSTRAN. (s. d.). https://www.systransoft.com/fr/systran/technologie/traduction-automatique/
- Alphatrad France. (2021, 2 avril). Traduction humaine VS traduction automatique : quelles différences ? https://www.alphatrad.fr/actualites/traduction-humaine-vs-traduction-automatique-quelles-differences
Sous-titrage ou doublage ?
Par Benjamin Tuffery, Master TPS promotion 2021-2023
Vaut-il mieux visionner du contenu en version française ou en version originale sous-titrée ? Voilà encore un débat sans fin dans lequel chaque parti possède des avantages, des inconvénients et des arguments pour se défendre.
Le choix de regarder des films et séries en VF ou VOST reste somme toute une question de goût et d’habitude. Il n’existe pas de bon ou de mauvais choix, cet article n’a d’ailleurs pas pour vocation de démontrer quelle version est la plus adaptée pour apprécier une oeuvre ou de vous influencer dans vos préférences de visionnage, mais plutôt d’expliquer le processus de traduction et ses contraintes nécessitant des choix pouvant amener le public à se questionner sur la qualité d’une traduction ou d’une adaptation lors du visionnage. Zoom sur ces deux disciplines de la traduction audiovisuelle.
Depuis l’arrivée d’internet et la facilité d’accès à tous types de contenus, nombreux sont ceux ayant pris goût à regarder les productions audiovisuelles en version originale.
Regarder un film, une série en version originale sous-titrée peut permettre une meilleure immersion. Cependant, bien que le sous-titrage a pour but de retranscrire au mieux ce qui est dit en VO, il existe certaines règles à son édition.
Des contraintes lexicales imposent à l’auteur de créer des phrases fluides afin de permettre une lecture naturelle pour que le public ne se concentre pas plus sur la lecture que sur le visionnage. Contrairement au doublage, les sous-titres doivent gommer tout marqueur d’oralité comme les « like » ou encore « you know ». Ils doivent aussi respecter les règles de grammaire française. Ainsi, un « Dunno » à l’oral ne sera pas écrit « J’sais pas », mais bien « Je ne sais pas », car, peu importe le degré d’intelligence du public, le cerveau humain lira plus facilement un texte respectant les règles de français.
À cela s’ajoute une limite au nombre de caractères maximum par seconde devant apparaitre à l’écran, en effet une personne lit en moyenne 14 à 15 caractères par secondes.
Ces exigences font du sous-titrage, un travail de concision. De ce fait, certains éléments peuvent-être omis et des raccourcis de sens peuvent être utilisés, sans doute vous êtes-vous déjà dit « Ce n’est pas du tout ce qui est dit. », eh bien ces éléments expliquent pourquoi c’est parfois le cas.
Les versions françaises, quant à elles, proposent une meilleure accessibilité, pour les enfants par exemple ou pour toute personne ne voulant pas s’embêter à lire de sous-titres. Certains tout simplement ne sont pas à l’aise avec les langues étrangères et préfèrent entendre des voix françaises.
La création de VF de productions audiovisuelles n’a pas à s’occuper des points de vigilance évoqués plus haut, ce qui offre une certaine liberté syntaxique. Pour autant, le travail d’auteur de doublage reste tout aussi pointilleux que celui d’auteur de sous-titres. Hormis la difficulté d’écriture que peuvent rencontrer tous les traducteurs, quel que soit leurs domaines de travail, l’auteur de doublage doit adapter son texte aux mouvements labiaux des acteurs ou encore à la vitesse à laquelle l’acteur parlera en langue originale. Ces contraintes imposent parfois de devoir trouver une traduction autre que celle qui serait la plus adaptée au niveau du sens et proposée en sous-titrage.
Une bonne VF – outre la qualité de la traduction – repose aussi sur le jeu d’acteur des comédiens de doublage qui eux aussi peuvent apporter leur pierre à l’édifice et proposer des idées de traduction ou des synonymes de la traduction déjà proposée par l’auteur de doublage.
Ces deux disciplines, malgré leurs différences, ont la même mission : présenter au spectateur une traduction fluide et naturelle pour contribuer à la bonne immersion de celui-ci et tout comme en traduction littéraire, rendre au mieux le style de l’auteur.
Aujourd’hui, avec les plateformes de vidéos à la demande ou la possibilité de regarder un film en VOST ou VF – que ce soit au cinéma ou à la télévision – profitons de pouvoir choisir entre une version ou l’autre selon nos préférences tout en respectant le travail fourni pour traduire ces productions.
Pour aller plus loin :
Jean-Paul Aubert, Marc Marti, U. de Nice : Quelques conseils pour le sous-titrage
Parlons VF : Interview Donald Reignoux
Brigitte Lecordier : Les auteurs de VF, Hier et aujourd’hui
Le sous-titrage et le doublage au cinéma, entretien avec Maï Boiron – JournalsOpenEdition
En quoi consiste le doublage et son importance en marketing – 1min30.com
Être traducteur audiovisuel – ATAA
La traduction dans le sport
Par Gabrielle Robin, Master TPS, promotion 2021-2023
Le sport. Tout le monde est familier avec ce terme, mais également avec la discipline en tant que telle. Qu’on soit passionné ou non par le sport, nous nous sommes tous retrouvés un jour à l’école, face à deux capitaines d’équipe, la boule au ventre à l’idée d’être choisi en dernier.
Mais quelles sont les origines du sport ? “Quel lien avec la traduction ?”, me demanderez-vous. Soyez patients.
Il faut savoir que le terme “sport” est en réalité issu de l’ancien Français “desport” qui faisait référence au divertissement ainsi qu’au plaisir physique ou de l’esprit. Au XIVe siècle, ce mot fut très vite exporté en Angleterre et, au fil des siècles, il s’est transformé en “disport” puis en “sport”.
Aujourd’hui, il va sans dire que les Etats-Unis exercent une influence majeure dans le milieu sportif, ce qui donne lieu à une évolution terminologique de plus en plus importante dans le domaine de la traduction.
Pour illustrer ce phénomène, parlons par exemple de la course à pied, un sport qui s’est démocratisé aux Etats-Unis. Aujourd’hui et depuis maintenant des années, les Français sont nombreux à s’y être initié. Venons-en au but : la place des anglicismes dans la traduction à la suite de cette influence états-unienne.
En 2014, la Fédération Française d’Athlétisme a réalisé une étude selon laquelle 9,5 millions de personnes déclaraient pratiquer la course à pied. En parallèle, les revues et les magazines français spécialisés dans le sport se sont multipliés, et beaucoup d’entre eux possèdent le terme run dans leur titre : Runner’s World, Running Attitude, Run-Sport, etc. Vous l’aurez compris, on ne parle quasiment pas de course à pied, mais bien de running. Ce n’est évidemment pas le seul terme concerné puisqu’on parle également d’aller faire un jogging, terme une nouvelle fois apparu aux Etats-Unis puisque c’est là-bas qu’a eu lieu le premier marathon – à New-York, en 1970.
La course à pied n’est pas le seul sport concerné, le CrossFit est également un très bon exemple puisqu’il utilise bon nombre d’anglicismes, notamment pour le matériel (kettlebell), le contenu des séances (skills, metcons) ou même un exercice, connu maintenant de tous : les squats.
Les exemples de sports touchés par les anglicismes sont nombreux, il serait donc difficile de tous les citer. Il est tout de même intéressant de parler de ces sports « vintage » qui reviennent à la mode, à la seule différence que leur nom a changé et que l’on ne parle par exemple plus de patin à roulettes mais de roller. La planche à voile, quant à elle, se transforme progressivement en windsurf.
L’objectif de cet article n’est pas de dénoncer l’influence massive exercée par les Etats-Unis dans le milieu du sport, mais bien de penser à la place d’un traducteur de presse sportive et de se demander : doit-il évoluer avec son temps et utiliser des anglicismes ou doit-il essayer de les traduire ?
Il est certain qu’un traducteur qui exerce le domaine, en l’occurrence le sport, qu’il traduit et qui connaît l’histoire du sport en question, aura plus de facilités à effectuer ce travail de réécriture et d’adaptation qu’est la traduction sportive. Le choix d’utiliser des anglicismes ou d’essayer de les traduire lui revient, mais une question, que je vous pose aujourd’hui, persiste tout de même :
Si l’on se met à la place d’une personne qui commence l’apprentissage d’un sport et ne connaît aucun terme, ne serait-il pas plus facile pour elle de lire des articles dans lesquels tout est traduit ?
Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le sujet, voici les références qui m’ont moi-même aidée dans la rédaction de cet article :
- L’histoire du sport aux Etats-Unis / oemglass.net
- Monrozier, E. (2016). Les anglicismes dans les sports de glisse. Revue française de la traduction, (234), 69-74.
- Orsal, L. (2016). Traduire pour la presse sportive : l’exemple de la course à pied. Revue française de la traduction, (234), 75-80.
- Quelles sont les origines du sport ? – Foxoo
Analogie entre la traductologie et la philosophie
Par Emilie Kröger, Master TPS, promotion 2021-2023
Férue des sujets complexes et des pistes interprétatives à creuser, je vous propose aujourd’hui d’établir un lien entre ces deux disciplines qui, au premier abord, ne semblent (presque) rien avoir en commun : la philosophie et la traductologie.
D’un côté, nous avons la philosophie, une discipline vieille comme le monde. On a du mal à dater la naissance de cette discipline, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle a plus de 2000 ans. De l’autre, la traductologie n’existe que depuis le début des années 1960 (si on prend la discipline). Mais nous allons voir que, malgré leur grande différence d’âge, ces deux disciplines ont des points communs.
L’analogie entre traductologie et philosophie a d’ailleurs déjà été abordée lors du colloque « Traduction et Philosophie » à l’Université de Liège en 2017. Ce colloque avait comme objectif de « présenter les recherches les plus récentes sur les liens qui unissent philosophie et traduction ». Parmi les conférenciers invités, il y avait Barbara Cassin, philosophe et membre de l’Académie française, autrice de l’ouvrage « Éloge de la traduction – Compliquer l’universel » (2016) ou encore « Les Maisons de la sagesse – Traduire » (2021). Ce dernier a d’ailleurs fait l’objet – entre autres – d’un podcast publié en octobre 2021 par France Culture : « La traduction ou l’art de faire avec les différences ».
Ce colloque a traité la question de la traduction de la philosophie, mais l’aspect qui fait l’objet de ce billet est celui de la philosophie dans le processus de traduction et donc son influence dans la traductologie.
En effet, l’étude de la traductologie mène déjà à de nombreux questionnements, ce sont en quelques sortes les bases mêmes de cette discipline. Comme la philosophie, la traductologie soulève un certain nombre de problématiques auxquelles nous sommes confrontées lorsque nous traduisons.
En voici quelques-unes :
- Traduire est-ce trahir ?[1]
- Qu’est-ce qu’une traduction éthique ?
- Comment traduire « l’intraduisible » ?
- Que signifie rester « fidèle » à un texte ?
- Peut-on réellement parler de « perte » et de « profit » en traduction ?
- La traduction constitue-t-elle un produit social ?
- La traduction est-elle une activité idéologique ?
Toutes ces questions font ou ont fait l’objet de théories de la traduction. En étudiant ces différents traductologues, on se rend compte que ces théories qui en émanent sont le fruit de leur propre réflexion et leur propre avis et que finalement, la traductologie est aussi sujet au débat que la philosophie et ses différents thèmes. Les concepts sont donc variés, on remarque une émergence de plusieurs écoles et points de vue, comme le fait d’être sourcier ou cibliste, qui est finalement comme opposer hédonisme et épicurisme.
C’est à travers la simple lecture de ces questionnements qu’on se rend compte que le processus de réflexion en philosophie et en traduction sont très similaires. De plus, des questions d’ordre philosophique viennent également se poser en traductologie, telles que les grands thèmes de l’éthique et de la morale.
En somme, nous pouvons voir que les différents traductologues ont établis des théories différentes, en adoptant des points de vue différents, ce qui peut nous mener à la réflexion suivante : n’existe-t-il finalement pas autant de théories de la traduction qu’il existe de traducteurs ou même de personnes qui simplement réfléchissent à ces problématiques ?
Bibliographie/Recommandations :
Berman, A. (1995, 23 février). L’Épreuve de l’étranger : Culture et traduction dans l’Allemagne romantique (Tel, 252) (French Edition). GALLIMARD.
Boisseau, Maryvonne. « De la traductologie aux sciences de la traduction ? », Revue française de linguistique appliquée, vol. xxi, no. 1, 2016, pp. 9-21.
Hatim, B. & Mason, I. (1996, 12 décembre). The Translator As Communicator (Wiley Series in Solving Large-Scale) (1re éd.). Routledge.
Laaksonen, J. & Koskinen, K., 2020. “Venuti and the Ethics of Difference”. In Koskinen, K. & Pokorn, N. K. (eds.): The Routledge Handbook of Translation and Ethics. Routledge, 16 p. (Routledge Handbooks in Translation and Interpreting Studies).
Ladmiral J. R. Sourcier ou cibliste. Les profondeurs de la traduction, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Traductologiques », 2014 ; 2e éd. revue, 2016.
Meschonnic, H. (2007, 26 octobre). Éthique et politique du traduire (Verdier).
Podcast France Culture « La traduction ou l’art de faire avec les différences » avec Barbara Cassin, 9 octobre 2021 : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/science-en-questions/la-traduction-ou-l-art-de-faire-avec-les-differences-5536928
Présentation du colloque « Traduction et Philosophie » à l’Université de Liège avec Barbara Cassin, Marc de Launay & Lisa Foran, 12 avril 2016 : https://www.fabula.org/actualites/73629/colloque-traduction-et-philosophie-5-7-mai-2017.html
Tatiana Milliaressi. La Traduction: philosophie, linguistique et didactique. Villeneuve d’Ascq, France. Editions du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 444 p., 2009, UL3 Travaux et recherches, 978-2-84467-112-7.
Vezin, François. « Philosophie et pédagogie de la traduction », Revue philosophique de la France et de l’étranger, vol. 130, no. 4, 2005, pp. 489-501.
[1] « traduttore, traditore » (adage italien), https://lactualite.com/societe/traduire-cest-trahir/
« Ah t’es traducteur, t’es bilingue alors ? »
Par Juliette Charlos, Master TPS, promotion 2020-2022
Quand vient l’heure de se présenter et d’annoncer (fièrement ?) quelle profession nous exerçons, ou le métier auquel nous nous préparons, nous sommes confrontés à de multiples réactions. Dans l’imaginaire de certains, le traducteur est une sorte d’ermite terré dans son bureau toutes les nuits à traduire des livres, celui qui traduit les joueurs étrangers à la télé, pendant les interviews d’après-match ou bien encore un écrivain raté… Mais l’idée reçue la plus répandue est probablement celle que les traducteurs sont des bilingues, voire des trilingues. Alors, vrai ou faux ?
Posons-nous tout d’abord la question à l’envers : est-ce que tous les bilingues sont des traducteurs ? La réponse est unanime, n’est-ce pas ? Alors demandons-nous si tous les bilingues peuvent être traducteurs et s’il faut être bilingue pour devenir traducteur.
Si la traduction consiste bel et bien à passer d’une langue à une autre, l’acte traductologique peut s’avérer plus complexe qu’il n’y paraît. Tout d’abord, dans le cas de la traduction technique, nous pouvons être amenés à traduire des documents sur des sujets très spécialisés que l’on ne maîtrise pas, même dans notre langue maternelle. Prenons un exemple : fraiseuse à commande numérique. Bilingue ou non, face à cette situation, le traducteur va devoir se documenter sur le domaine industriel pour savoir, premièrement, à quoi fait référence ce terme, et deuxièmement, quel est son équivalent dans la langue cible. C’est là l’une des premières compétences que doit avoir un traducteur : savoir où et comment faire des recherches afin de trouver LA bonne traduction, si tant est qu’il en existe une.
Une autre des compétences indispensables pour être traducteur est l’excellente maîtrise de la langue dans laquelle il traduit, généralement sa langue maternelle. Cependant, il est rare d’avoir une maîtrise équivalente de deux langues, à l’oral et à l’écrit. Très souvent chez les personnes bilingues l’une des deux langues est dominante ; il y a un déséquilibre étant donné que l’une et l’autre vont être utilisées dans des domaines ou des activités différents. Prenons l’exemple d’une famille anglaise expatriée en France, constituée de deux jeunes enfants qui commencent tout juste à parler et de deux parents qui ne communiquent qu’en anglais au sein du foyer. Les enfants vont naturellement apprendre à parler en anglais chez eux mais vont en même temps apprendre à parler français à l’école. Au cours de leur scolarité, les sujets qu’ils aborderont, en français, seront probablement bien différents de ceux qu’ils aborderont avec leurs parents, en anglais. Alors, tout un vocabulaire spécifique va se développer. Ces enfants pourraient être à terme capables d’animer des conférences en français sur des sujets très poussés dans des domaines tels que l’ingénierie, la médecine, la technologie, mais ils ne seront pas nécessairement capables de le faire dans leur langue maternelle.
Par ailleurs, le métier de traducteur mobilise des compétences autres que linguistiques telles que la maîtrise des outils informatiques qui font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien, notamment les logiciels de TAO (traduction assistée par ordinateur). C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe de nombreuses formations pour devenir traducteur qui n’auraient donc pas lieu d’être s’il suffisait d’être bilingue.
Alors bilingue ou non, si vous maîtrisez parfaitement votre langue maternelle, si vous êtes curieux et aimez vous documenter sur divers sujets et que vous n’êtes pas allergiques aux nouvelles technologies, le métier de traducteur est peut-être fait pour vous.
Pour aller plus loin :
http://thebilingualadvantage.com/quest-ce-que-le-bilinguisme/
https://www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2014-3-page-182.htm(rapport bilinguisme et double personnalité)
La traduction médicale, une discipline passée sous scalpel
Par Margot Degardin, Master TPS, promotion 2020-2022
La médecine, bien que particulièrement attrayante, est avant tout un domaine extrêmement vaste et précis. C’est pourquoi, il est primordial que la traduction d’un document médical soit entre les mains d’un traducteur professionnel. La fiabilité de ce type de traduction est vitale et l’erreur n’y a pas sa place.
La traduction médicale, c’est quoi ?
La traduction médicale fait référence à la traduction de documents médicaux mais, plus précisément, aux documents provenant du domaine de la santé (biologique, pharmaceutique, paramédical, etc.). Les documents qui composent la traduction médicale sont donc aussi nombreux que variés : dossiers médicaux, rapports de test, études pharmacologiques, articles de revues médicales, protocoles d’essai clinique, formulaires de consentement éclairé, notices d’utilisation, brevets, fiches techniques de matériel médical, etc. Tous ces documents rassemblent une terminologie conséquente devant être confiée à des traducteurs spécialistes du domaine.
Quel est le profil d’un bon traducteur médical ?
La traduction médicale est une spécialisation de la traduction présentant une des plus grandes responsabilités. Un traducteur médical doit savoir faire preuve de minutie et doit être particulièrement rigoureux. De plus, celui-ci se doit d’avoir une excellente connaissance du vocabulaire spécialisé du domaine dans lequel il exerce. En effet, une seule erreur de terminologie peut s’avérer, dans certains cas, fatale ou avoir de graves répercussions. La délicatesse et l’importance des documents à traduire sont à prendre avec beaucoup de sérieux. Les confusions n’ont pas leur place dans ce domaine. Enfin, un bon traducteur médical, comme tout traducteur, doit également être en capacité de s’adapter à son public. Effectivement, la terminologie choisie ne sera pas la même entre la traduction d’un diagnostic rédigé par un professionnel pour un professionnel et la traduction d’un diagnostic rédigé par un professionnel pour un patient.
Quels sont les points de vigilance en traduction médicale ?
La médecine est un domaine enclin aux changements. En effet, le monde de la santé est en constante évolution et le traducteur médical doit, régulièrement, se tenir au courant des avancées du secteur car nouvelle technologie rime forcément avec nouvelle terminologie. De plus, bien que l’on puisse penser le contraire, les nomenclatures de ce domaine changent parfois elles aussi. Par exemple, depuis 1998, c’est la Terminologia Anatomica qui représente la terminologie officielle concernant l’anatomie humaine. Il existe une traduction officielle de cet ouvrage en anglais mais très peu de langues ont eu cette chance. C’est pourquoi, certaines professionnels se réfèrent encore à la Nomina Anatomica, une classification anatomique plus ancienne. Il est également nécessaire de préciser que la traduction médicale est une discipline où se cachent de nombreux faux-amis au niveau de la terminologie.
En voici quelques exemples :
- Condition ne se traduit pas par « condition » en français, mais plutôt par « état ».
- Drug ne se traduit pas forcément par « drogue » en français, mais par « médicament » dans un contexte médical.
Pour conclure, un traducteur spécialisé dans le domaine médical doit allier rigueur, minutie et sérieux afin d’aider les patients et de contribuer à l’avancée perpétuelle de la médecine en général.
Bibliographie :
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n38-tradyterm_Vandaele-GingrasH.pdf
Traduire les langues c’est traduire les cultures
Par Camille Grondin, Master TPS, promotion 2020-2022
La traduction est le passage d’un texte d’une langue source vers une langue cible. Cela signifie, par définition même, que la traduction est une pratique interculturelle et que le traducteur est l’agent, le médiateur, garant de cette passerelle. Dans un monde cosmopolite et interconnecté, tout traducteur doit avoir conscience des enjeux culturels qui entourent son travail. La langue étant un produit social, elle est donc intrinsèquement liée à la culture.
Cependant, qu’est-ce que la culture ? Derrière ce mot aux apparences simples se cache un concept plus complexe. La culture est un ensemble disparate d’héritages et de traditions, de mentalités et de visions du monde, de représentations collectives, c’est-à-dire d’images d’autres cultures qu’un peuple se construit sur la base de ses propres symboles.
La culture dans laquelle nous avons évolué est tellement induite que nous ne nous rendons plus compte qu’elle fait partie de notre identité. Les relations entre culture langue et sociétés sont complexes. Consciemment ou non, une langue nous apprend beaucoup sur le mode de fonctionnement et de pensée de la société qui l’utilise.
Le rôle du traducteur est de transmettre ce fonctionnement d’une langue vers une autre. En quelque sorte, le traducteur, en plus de son rôle de médiateur, possède un rôle de décodeur. En effet, c’est lui qui doit lire entre les lignes afin de comprendre l’essence du texte qu’il traduit pour le restituer de la meilleure manière possible.
Néanmoins, cette tâche est souvent la plus compliquée. Quid de l’implicite de certaines langues, quid des jeux de mots, des néologismes et de toute création originale faites par les locuteurs de la langue (exemple du verlan en français). Aucune langue n’est le calque parfait d’une autre, c’est pourquoi la traduction est une vraie discipline.
Outre le fait que la traduction est le passage d’une langue à une autre, elle est aussi et surtout le rapprochement de deux cultures. Cependant, rapprocher deux langues avec des cultures plus ou moins éloignées n’est pas évident et n’exclut pas les interférences linguistiques et culturelles caractéristiques du métier de traducteur. S’il est parfois intéressant que la traduction adapte un texte de telle sorte que le lecteur puisse le comprendre, il ne faudrait pas non plus annihiler toute trace d’étrangeté qui ferait perdre tout son sens au texte source. À nous de trouver la balance entre ces deux réalités.
Je finirais ce petit texte de réflexion en insistant sur le fait que la rencontre entre deux cultures (et donc entre deux langues), n’est pas toujours évidente et constitue souvent des points de frictions. C’est ce que nous dis d’ailleurs Geneviève ZARATE, spécialiste française de la didactique des langues et des cultures lorsqu’elle écrit : « Une communauté culturelle construit son identité sur la base d’un rapport de force avec l’autre, mettant en place, à travers la circulation d’implicites culturels, des moyens d’autant plus efficaces qu’ils sont discrets pour exclure ceux qui ne partagent pas ces implicites ». Ainsi, il en va du rôle du traducteur d’inclure et de partager la langue et la culture qu’il traduit au reste du monde.
Camille Grondin
Bibliographie :
https://journals.openedition.org/palimpsestes/1525
https://www.fabula.org/actualites/traduction-et-interculturalite_21636.php
https://bilis.com/blog/traduction-culture-constructive-interdependance/
Journée avec une traductrice aux multiples casquettes
Par Chloé Bujeau, Master TPS, promotion 2020-2022
En mai 2021, j’ai eu la chance de passer une journée avec une traductrice, Pia Gabrielle Edström Bourdeau. Cette journée était organisée en lien avec la Société française des traducteurs, afin de permettre aux étudiants en première année de master de découvrir un peu plus le monde de la traduction.
Pia m’a donc accueilli chez elle, à Nantes. Comme peuvent le laisser deviner son prénom et son nom de famille, Pia est d’origine suédoise, mais pas seulement. On peut pratiquement dire qu’elle a plusieurs nationalités puisqu’elle a vécu en Espagne, en France, en Suède et en Allemagne. Grâce à cette vie de globe-trotteuse, elle est capable de traduire depuis l’anglais, le suédois, le norvégien, l’allemand, l’espagnol, vers le suédois et le français. Ses études d’ingénieur, effectuées à Paris et à Stockholm, lui ont donné l’opportunité de travailler chez Renault en France ainsi que pour des fabricants industriels en Allemagne. Ses études et ses expériences professionnelles, ont donc permis à Pia de se mettre à son compte en devenant traductrice indépendante dans le domaine technique, en 2002.
Lorsque je suis arrivée devant chez elle, j’ai tout de suite été intriguée par l’imposant drapeau suédois qui flottait grâce au vent. La présence de ce drapeau n’était pas anodine. En plus d’être traductrice, Pia est consule de Suède à Nantes. Son rôle est donc de porter assistance à tous les ressortissants suédois vivant dans le nord-ouest de la France principalement. J’ai été agréablement surprise puisque le monde de la diplomatie m’a toujours intéressée et c’était donc l’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement d’un Consulat et sur la fonction de consul. Malgré ces deux activités très prenantes, Pia trouve aussi le temps de jouer du violon. J’ai pu apprécier ses talents de musicienne durant une rencontre qu’elle, ainsi que quatre autres traductrices, toutes membres de la SFT, avaient organisée pour se rencontrer entre professionnelles et casser la potentielle solitude du métier de traductrice indépendante. Une autre des traductrices jouait aussi d’un instrument. Les deux mélomanes nous avaient donc préparé un petit concert. J’ai été ravie de pouvoir rencontrer d’autres traductrices qui avaient chacune une spécialité différente et de pouvoir discuter avec une d’entre elles, qui a aussi fait ses études de traduction à l’Université Catholique de l’Ouest, 20 ans plus tôt.
Passer la journée avec Pia m’aura permis de me rendre compte de ce qu’être traducteur indépendant impliquait, de comment il était possible de travailler et de gérer son temps. J’ai aussi pu en savoir plus sur les parcours d’autres traductrices, qui étaient tous différents. En bref, cette journée n’aura pas seulement été un aperçu du monde de la traduction indépendante, mais aussi une découverte d’une multitude d’autres choses auxquelles je ne m’attendais pas. Le fait que les étudiants en première année de master puissent passer une journée en immersion est, selon moi, très bénéfique, car cela permet de rendre les choses plus concrètes, après presque une année de formation. Je recommande donc fortement, aux étudiants et futurs étudiant, d’accepter de participer à cette journée très enrichissante !
Pour en savoir plus sur Pia Gabrielle Edström Bourdeau ou la contacter :
https://fr.linkedin.com/in/pia-gabrielle-edström-bourdeau-7459481
https://www.sft.fr/fr/prestataire/edstrom-bourdeau-pia-gabriella
Les anglicismes : bonne ou mauvaise idée ?
Par Alan Aubert, Master TPS, promotion 2020-2022
Casting, blacklister, brainstorming. Le point commun de tous ces mots : ce sont des termes issus de l’anglais. Leur autre point commun : ils figurent dans le dictionnaire français. Malgré tout, ils peuvent être remplacés par des traductions plus ou moins efficaces : « audition », « inscrire sur liste noire », « remue-méninges ». Un choix entre anglicisme et français s’impose alors.
Des arguments existent dans les deux sens : la langue de la France est le français, c’est par ailleurs ce qu’indique la loi : « le français est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics ». L’Académie française s’y mêle aussi, en toute légitimité, et se permet de trancher entre anglicisme et français. En outre, nous retrouvons sur son site Internet une sous-catégorie spéciale « Néologismes et anglicismes », faisant elle-même partie de la catégorie « Dire, Ne pas dire ». Par exemple, ne dites plus « ce soir, je vais chiller », dites « ce soir, je vais me détendre » !
Si l’on se met du point de vue des puristes, il faut admettre que le français est une langue extrêmement riche, de telle manière qu’il serait en effet dommage de s’en priver pour désigner un concept. Mais le fait est que le français, comme toute langue, évolue au fil du temps. Ce sont les locuteurs qui la façonnent, qui établissent les usages. Ainsi, les anglicismes, bien qu’ils puissent se révéler frustrants pour ces puristes, sont employés par une grande partie des locuteurs. Ils font bel et bien partie de notre langue.
Et le traducteur dans tout ça ? Comment doit-il procéder en rencontrant ces mots dans un texte anglais ? En réalité, il peut faire comme bon lui semble, mais il ne doit pas oublier qu’il ne traduit pas pour lui mais pour un public donné. S’il souhaite se faire comprendre et rendre son texte accessible, il doit obligatoirement prendre en compte la façon de parler des locuteurs.
En revanche, il n’est absolument pas question d’abandonner le français ni d’obliger l’utilisation des anglicismes, mais simplement d’accepter l’idée que l’anglais (ou n’importe quelle autre langue) s’intègre dans notre langage. Nous pensons qu’il ne faut pas l’interdire ni le rejeter, comme certaines personnes pourraient le penser. Bien au contraire, nous pouvons en profiter pour élargir notre vocabulaire et notre culture. Le traducteur est l’un des garants de cette « mission », car il est l’un des garants de notre langue.
Enfin, ces mêmes personnes qui dénoncent les anglicismes utilisent elles-mêmes des mots issus d’autres langues qui se sont fait une place dans nos discussions : café (de l’arabe), moustache (de l’italien), etc. Pourquoi ces mots seraient-ils plus légitimes que d’autres ?
Et vous, que pensez-vous de l’arrivée de tous ces nouveaux mots dans la langue française ?
Pour en savoir plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005616341/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037460897
https://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/neologismes-anglicismes
LE MÉTIER DE CHEF DE PROJET EN TRADUCTION, C’EST QUOI ?
Par Jade Roy, Master TPS, promotion 2020-2022
Définition :
Tout d’abord, il faut savoir que le #chef de projet est l’interface et le médiateur entre les différents intervenants d’un projet. Il est responsable du bon déroulement de ce dernier.
Typiquement, un chef de projet en traduction est issu du milieu de la traduction. Il peut être traducteur, éditeur ou relecteur, ingénieur… Tout simplement, une personne qui a fait ses premiers pas dans le milieu de la #traduction.
Le plus important dans le travail d’un chef de projet, c’est la communication avec le client final. Le client qui confie la traduction d’un projet à une agence de traduction le fait pour deux principales raisons : la première, parce qu’il n’a pas les ressources en interne, la seconde, parce qu’il n’a pas le savoir-faire en interne. Alors, ce savoir-faire, dont il ignore tout dans la plupart des cas, il suppose que son interlocuteur le possède.
Les compétences requises pour être chef de projet :
Pour réussir dans ce métier, il faut être sociable et aimer le contact avec les autres. Non seulement, il faut parler régulièrement avec l’équipe de traducteurs, mais aussi avec le client pour écouter ses besoins et le rassurer sur le déroulement de son projet.
D’autre part, il faut être flexible et réactif par rapport aux différentes sollicitations et requêtes. Donc, avoir l’aptitude à travailler en groupe, gérer le stress et comprendre les gens sans les contacter physiquement est indispensable.
Les principales tâches d’un chef de projet :
- Analyser la demande du client et envoyer un devis personnalisé
- Établir un planning du projet : intervenants, date de livraison et coûts
- Communiquer en continu avec le client et l’équipe de traducteurs
- Choisir le traducteur approprié selon la langue et le domaine traité
- Collecter les documents sources et si nécessaire, convertir le fichier source au format approprié
- Superviser le bon déroulement de la traduction qui peut parfois impliquer la mise en page ou l’insertion de textes dans les images
- Assurer le contrôle qualité en confiant le document traduit au réviseur
- Valider et livrer le travail effectué par e-mail
- Traiter les réclamations ou les éventuels problèmes de non-satisfaction, le cas échéant. Pour ce faire, la diplomatie et l’écoute doivent également s’ajouter aux qualités requises chez le chef de projet.
En bref, si…
- Vous avez un Bac+5, une expérience de la gestion de projets multilingues en agence,
- Vous pratiquez deux langues étrangères,
- Vous savez utiliser les outils de TAO (SDL Trados…), Word, Excel,
- Vous avez le sens des relations clients,
- Vous résistez au stress,
- Vous aimez le travail en équipe,
- Vous êtes organisé, rigoureux, responsable, perfectionniste, polyvalent, motivé, flexible, dynamique,
- Vous savez prendre rapidement des décisions et résoudre des problèmes,
- Vous savez gérer une équipe, planifier et respecter des délais,
…vous pourriez correspondre à ce #métier !
Et vous, par quelles qualités, dont doit disposer un chef de projet, êtes-vous concerné ? N’hésitez pas à répondre en commentaires !
Pour en savoir plus :
Devenir Chef de projets en traduction – Fiche métier Chargé de projets en traduction | ESTRI
▷ Le métier du chef de projet en traduction (translatonline.com)
Le métier de chef de projets chez Anyword, agence de traduction
Vis ma vie de chef de projet de traduction | BeTranslated
Fiche métier Assistant (e) Chef de Projet Traduction | LeGuideDesMétiers (leguidedesmetiers.fr)